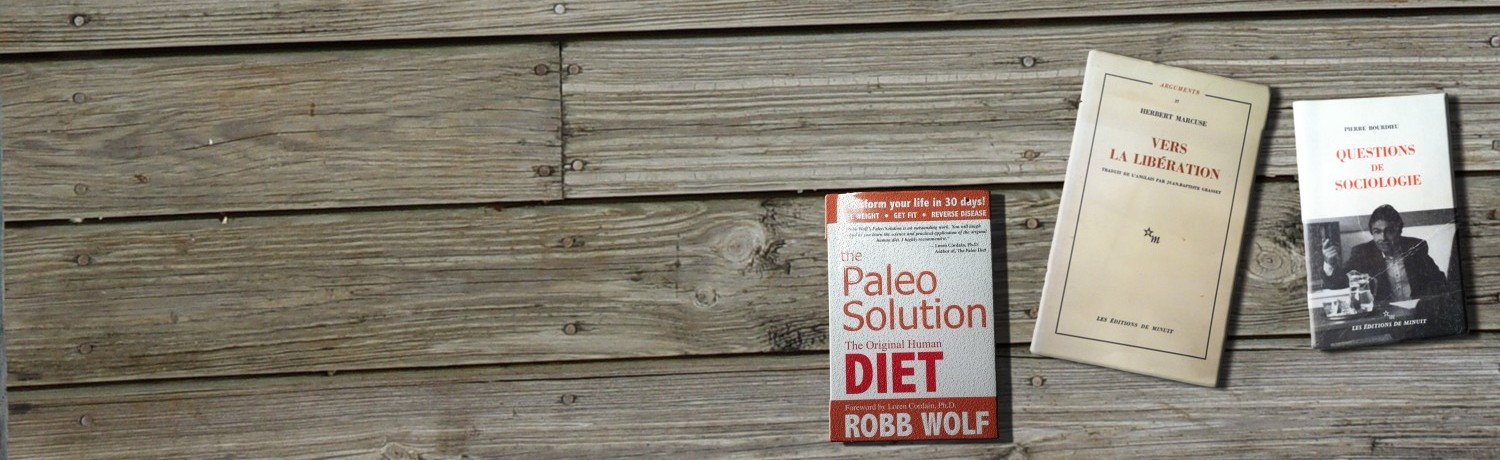Ecrire sur un présent qui est en train de se dérouler devant nos yeux n’est jamais facile. On manque de recul. On risque de donner de l’importance à des faits qui sont artificiellement gonflés par les médias, et que l’Histoire renverra au statut d’anecdotes. Et on risque d’être guidé par l’émotion, plus que par l’observation rigoureuse des faits.
Bref, c’est casse-gueule.
Mais en même temps, si on ne le fait pas, on laisse la place à celles et ceux que ça ne gêne pas d’écrire dans l’instant, dans l’émotion (et souvent d’ailleurs, dans le but de susciter l’émotion).
Ce que je vais écrire ici se base sur ce quoi je travaille depuis 6 ans : les mouvements qui émergent dans un contexte de crise des institutions auxquelles on a délégué, durant des décennies, le pouvoir de décider à notre place ; ce que j’ai appelé « la crise de la délégation ». En 6 ans, ça m’a permis d’observer l’émergence et l’échec de certains de ces mouvements. Je pense par exemple aux Printemps arabes, au mouvement Nuit Debout, etc. J’ai pu observer les causes de leur émergence… et les conséquences, parfois, de leur échec.
Aucune théorie ne permet de prévoir l’avenir. Je ne sais pas sur quoi va déboucher la mobilisation des « gilets jaunes ». Mais j’ai l’impression qu’il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer.
Je suis convaincu qu’une théorie est avant tout un outil pour observer le réel. On pourrait prendre l’image de lunettes : si vos lunettes ne vous permettent plus de voir les obstacles sur votre chemin, et que vous vous cassez constamment la gueule, c’est que vos lunettes ne sont plus adaptées. A l’inverse, si vous avez l’impression d’y voir très clair, du moindre détail jusqu’à la « big picture », c’est probablement que vos lunettes sont bien adaptées.
Dernière précaution : je vais appeler ce texte « Gilets jaunes et crise de la délégation – Version #1 », pour pouvoir éventuellement le retravailler au fur et à mesure des événements.
Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet…
La faillite des corps intermédiaires = On ne veut plus « déléguer »
Ce qui saute le plus aux yeux est le fait que les manifestations des gilets jaunes constituent une mobilisation qui n’est pas organisée par un parti politique ou une organisation syndicale. Plus encore, ils rejettent globalement le rattachement à tout parti ou tout syndicat. Ils se posent également comme très méfiants vis-à-vis des médias traditionnels.
Partis, syndicats et médias représentent ces instances, ces institutions, à qui on a délégué le pouvoir de parler et de décider à notre place : ils parlent au nom des Belges ou des Français, au nom des travailleurs, au nom de l’ « opinion publique ». En sociologie, c’est, à mon sens, Pierre Bourdieu, qui a le mieux exploré ce principe de la « délégation », dans un texte intitulé « La délégation et le fétichisme politique » (1984).
Bourdieu définit la délégation comme le fait, pour une personne, de « donner pouvoir » à une autre personne, c’est-à-dire « le transfert de pouvoir par lequel un mandant autorise un mandataire à signer à sa place, à agir à sa place, à parler à sa place, lui donne une procuration, c’est-à-dire (…) le plein pouvoir d’agir pour lui ».
Le mouvement des sociétés occidentales, depuis le début de la Modernité, s’est fait dans le sens d’une délégation toujours plus grande. Juste quelques exemples pour bien comprendre, même si ce n’est pas l’objet ici : nous avons progressivement délégué notre capacité à produire notre alimentation à une industrie, sur laquelle nous n’avons plus réellement d’emprise : nous ne savons plus où, comment, ni par qui, ont été produits les aliments qui arrivent dans nos assiettes. Et nous sommes totalement dépendants de cette industrie agro-alimentaire pour nous nourrir. Et il en va de même pour nous chauffer, nous déplacer, nous soigner, etc. Pour bien comprendre : l’inverse de la délégation, dans ces cas-ci, c’est : être capable de produire soi-même son alimentation, ou du moins connaître celle ou celui qui produit nos légumes localement, être capable de produire soi-même son énergie (individuellement ou au sein d’une coopérative locale), etc…
Vous avez compris l’idée ? L’inverse de la délégation, c’est reprendre les choses en main, c’est l’autonomie, c’est décider pour soi-même, individuellement ET collectivement. C’est ce qu’on appelle généralement « Empowerment ».
Au niveau politique, le mouvement de la délégation s’est fait au fur et à mesure que l’Etat se bureaucratisait, que les partis politiques devenaient des appareils de plus en plus puissants, et que les décisions se globalisaient. Aujourd’hui, nombreuses décisions se prennent entre élus et experts, au sein d’hémicycles qui nous paraissent extrêmement éloignés, autant géographiquement (Bruxelles, Strasbourg, etc.) que symboliquement (coupés de nos préoccupations).
Au niveau du travail, les syndicats, qui ne représentent plus que 10% des travailleurs français, parlent à notre place, négocient pour nous, nous disent ce qu’il est légitime de demander. De surcroit, ces syndicats sont plus ou moins politisés. Bien souvent, ils sont liés aux appareils politiques.
Elus et représentants syndicaux s’expriment en notre nom, dans des médias qui décident, pour nous, ce qui peut nous être ou ne peut pas nous être communiqué.
Ce modèle, dans lequel une toute petite minorité décide, pour la grande majorité, dans lequel cette grande majorité est uniquement invitée à donner un chèque en blanc aux candidats tous les 4, 5 ou 6 ans, est en crise. L’immense majorité de la population n’a plus confiance dans ces corps intermédiaires, dans ces médiations, que sont les partis, les syndicats et les médias.
En témoignent les baromètres de la confiance politique, réalisés par le CEVIPOF. Celui de janvier 2018 montrait que les organisations dans laquelle on a le moins confiance sont :
Les partis politiques : 0% « Très confiance », 9% « Plutôt confiance » ! Le reste se répartit entre « Plutôt pas confiance », « Pas du tout confiance » et « Ne sait pas ».
Viennent ensuite, presqu’à égalité, les médias, les banques, les syndicats. Tous à moins de 30% de confiance. Comprenez bien ce que cela signifie : 73% de la population n’a « plutôt pas » ou « pas du tout » confiance dans les médias.

Je le réécris, parce que c’est important : les organisations dans lesquelles les Français ont le moins confiance sont : les partis politiques, les médias, les banques et les syndicats. Ce sont les organisations à qui on a délégué le pouvoir de gérer notre pays, notre information, notre argent, et la défense de nos conditions de travail.
Nos représentants ne nous représentent plus. L’époque actuelle pourrait se résumer comme cela.
Et ce fossé se creuse depuis presque qu’une quarantaine d’années. On peut discuter sur cette temporalité et les événements déclencheurs, mais moi je fais remonter cela au début des années 80. Durant ces quatre décennies, les dirigeants ont eu mille occasions de prendre conscience de ce fossé grandissant, et du sentiment d’abandon, d’impuissance, de déréliction, de relégation qui émergeait dans une part toujours plus grande de la population : certains ont écrit des livres, d’autres ont rédigé des cahiers de doléances ; certains ont organisé des marches, d’autres ont bloqué des routes ; certains ont tenté de créer des partis citoyens, d’autres ont commencé à s’abstenir de voter… mais certains ont également brûlé des voitures, alors que d’autres se radicalisaient.
Mais rien de tout ça n’a été entendu… Rien. Les réponses ont été technocratiques, sécuritaires, institutionnelles. Plus la population essayait de manifester son existence, plus on la renvoyait à son illégitimité, à son invisibilité.
Je pense qu’on n’estime pas à sa juste valeur le symbole que représente le « gilet jaune », ce vêtement qui permet d’être visible, lorsque l’invisibilité est un danger : pour celles et ceux qui travaillent manuellement, celles et ceux qui sont « sur le bord de la route », celles et ceux qui travaillent la nuit. Il y a toute une symbolique. Le « gilet jaune » rend visible celles et ceux qui risquent de ne pas l’être… et nous sommes toutes et tous censés en avoir un dans notre voiture, parce que nous pouvons toutes et tous être dans ces situations.
Le paradoxe du délégué qui devrait expliquer qu’il ne veut plus déléguer.
« On pourrait, pour simplifier, dire que les dominants existent toujours, tandis que les dominés n’existent que s’ils se mobilisent ou se dotent d’instruments de représentation » (Bourdieu, 1984 : 261).
La mobilisation des gilets jaunes ne participe pas à la faillite des corps intermédiaires, elle en est la conséquence. Lorsqu’on ne peut plus déléguer à d’autres, on n’a pas d’autre choix que de reprendre les choses en main. Toute les théories sur les dynamiques d’« empowerment » montrent qu’elles démarrent toujours dans un contexte d’ « impuissance » : « powerlessness » en anglais.
Et la société construite sur le principe de la délégation, tout en faillite soit-elle, ne sait rien répondre d’autre à ces gilets jaunes que : choisissez-vous une délégation, et nous pourrons discuter. Choisissez-vous des porte-parole, pour les plateaux télé, pour le gouvernement.
Ça, c’est le gros débat actuel : qui sera porte-parole des « gilets jaunes » ? Et là, je dois quand même prendre un peu le temps d’expliquer ce que cela signifie, sociologiquement, de se choisir un porte-parole, élément central du principe de délégation. Notre société est tellement construite dessus, que c’est un impensé total de la politique, comme des médias.
Tout se passe comme si les gilets jaunes n’existaient pas, aux yeux des politiques et de nombreux journalistes, en particulier à la télé, tant qu’ils n’ont pas de « porte-parole ». Bourdieu l’expliquait très bien :
« (…) les individus – et cela d’autant plus qu’ils sont plus démunis – ne peuvent se constituer (ou être constitués) en tant que groupe, c’est-à-dire en tant que force capable de se faire entendre et de parler et d’être écoutée, qu’en se dépossédant au profit d’un porte-parole. » (Bourdieu, 1984, 260).
La presse, dit-il encore, « ne reconnait et ne connait que des porte-parole, vouant les autres aux ‘libres opinions’ » (Bourdieu, 1984, 264).
Chaque émission de télévision que j’ai pu voir, en France comme en Belgique, a tenté d’instituer des porte-parole des gilets jaunes. Certains ont joué le jeu, en s’autoproclamant porte-parole au nom de cette consécration médiatique soudaine, mais ils ont été directement conspués sur les réseaux sociaux.
« (…) l’usurpation est à l’état potentiel dans la délégation » (Bourdieu, 1984 : 265).
Un mouvement qui émerge dans ce contexte de crise de la délégation ne peut pas jouer le jeu de la délégation, quand bien même les institutions de la délégation les enjoindraient à le faire. Nombreux gilets jaunes que j’ai vus sur les plateaux de télévision ont passé beaucoup de temps d’antenne à répéter aux journalistes qu’ils n’étaient PAS « porte-parole ».

C’est d’autant plus important que la consécration médiatique ou politique des porte-parole est un acte « performatif » : en consacrant telle ou telle personne comme « porte-parole officiel » dans les médias ou auprès du gouvernement, médias et gouvernement donneront une orientation à la mobilisation. Ainsi, les médias peuvent à la fois déplorer des propos de droite, d’ « ultra-droite », voire d’extrême-droite au sein des gilets jaunes, et en même temps instituer, en France, Benjamin Cauchy, connu pour son affiliation à l’ « ultra-droite » en porte-parole des gilets jaunes. L’acte est performatif. Il fait advenir ce qu’il croit juste montrer.
C’est dans ce cadre-là qu’il faut également comprendre la volonté médiatique et politique de réduire l’ensemble des revendications des gilets jaunes à une revendication unique, si possible qui colle bien à la structure du champ politique : plutôt une baisse des impôts (ce qui permet de raccrocher ce mouvement à la droite), ou plutôt une lutte contre les inégalités sociales (ce qui permet de raccrocher ce mouvement à la gauche). Mais le problème est double : d’une part, « gauche » et « droite », ça ne parle plus qu’aux politiques, aux journalistes et aux syndicalistes ; et d’autre part, la mobilisation des gilets jaunes charrie un nombre incroyable de revendications disparates qui forment, toutes ensemble, le ras-le-bol généralisé d’une immense partie de la population.
C’est important : il faut comprendre la mobilisation des gilets jaunes comme une conséquence du fait qu’une grande partie de la population ne se sent plus écoutée par une caste politique fermée sur elle-même, structurée sur des oppositions qui n’ont plus de sens qu’au sein de cette caste elle-même… et on leur répond que pour être audibles, ils doivent structurer leur discours sur ces oppositions qui n’ont plus de sens pour eux.
« En fait, les individus à l’état isolé, silencieux, sans parole, n’ayant ni la capacité ni le pouvoir de se faire écouter, de se faire entendre, sont placés devant l’alternative de se taire ou d’être parlés » (Bourdieu, 1984 : 263).
Si la réponse des institutions à la mobilisation des gilets jaunes est précisément ce qui a été à l’origine de cette mobilisation, ça ne peut aller que vers une escalade, chaque réponse institutionnelle renforçant la mobilisation.
Les « beaufs » et l’ethnocentrisme de classe
Bien sûr, tout cela est d’autant plus vrai que la base sociale des gilets jaunes est plutôt populaire.
Interrogé par le site Contretemps.fr, le sociologue Benoît Coquard présente le milieu social des gilets jaunes qu’il a rencontrés comme allant « des classes populaires aux classes intermédiaires plutôt peu diplômées et exerçant des métiers manuels. »
Et c’est en observant le racisme de classe déchainé et décomplexé, en particulier sur Twitter, dont les premiers gilets jaunes furent victimes, qu’on peut comprendre le racisme de classe ordinaire qui est probablement aussi, en partie, à l’origine de la mobilisation. Renvoyés au statut de « beaufs », de « racistes », de « populistes », de « poujadistes », les gilets jaunes ont dès le début été renvoyés à leur illégitimité à revendiquer quoi que ce soit d’audible.


« Le langage dominant détruit, en le discréditant, le discours politique spontané des dominés » (Bourdieu, 1979 : 538). Surtout, le langage dominant, qui n’est jamais que le langage des dominants, renvoie les revendications des dominés aux intérêts particuliers, aux petites choses, à l’illégitime… comme le prix du diesel. Mais quel « beauf » faut-il être pour manifester pour du diesel polluant !
Comme toujours, ce qui est impensé dans ce rapport condescendant à l’Autre qu’on pense inférieur à soi, ce sont les conditions de possibilités. En province, dans les régions moins favorisées, la mobilité n’est pas pensée comme en ville. Et d’un milieu à l’autre, le rapport à l’argent n’est pas le même. Ce qui change, c’est la « nécessité ». Dans les témoignages des gilets jaunes, l’utilisation de la voiture n’est pas expliquée comme un luxe, celui par exemple de rouler en SUV, comme on l’a vu dans des tweets dénigrants. C’est une nécessité pour trouver ou garder un travail loin du domicile. Pas parce qu’on aime rouler une heure en voiture tous les matins, mais parce qu’il n’y a pas de travail près de chez soi.
L’ethnocentrisme de classe, c’est qui empêche de voir ce qui relève de la nécessité dans les « choix » de l’autre : c’est la différence entre le choix du « minimalisme », et un nombre minimal de choix, entre la simplicité volontaire et la simplicité involontaire. Ça m’a marqué qu’on entende plusieurs gilets jaunes prendre le même exemple : « on ne peut même plus se permettre d’offrir de cadeaux ». Comme une honte. Et la honte, disait Marx, est déjà une révolution.
Le prix du diesel n’était que la goutte qui a fait déborder le vase.
Ce qu’on entendait, dans les discours des gilets jaunes, c’était les fins de mois difficiles, l’endettement, la vie à crédit, l’impression de ne pas arriver à garder la tête hors de l’eau. Et une intelligentsia « bobo » leur en renvoyé, avec un mépris de classe incroyable, l’image d’une classe de « pauvres-qui-puent-le-diesel-le-racisme-et-l’homophobie ».
« Le populisme n’est jamais que l’inversion d’un ethnocentrisme » (Bourdieu, 1979 : 435).
Sur les plateaux de télé, le dialogue est impossible : les gilets jaunes (souvent relégués dans le public) parlent de fins de mois difficiles, les élus (à la table de discussion) leur répondent « augmentation du pouvoir d’achat », « tax shift » (en Belgique), ou fiscalité. Ils parlent de difficulté à se déplacer pour aller bosser, on leur parle d’empreinte carbone.
Benoit Coquard l’explique très bien dans l’entretien qu’il a donné à Contretemps :
« Une opposition s’exprime aussi clairement entre ceux « qui comprennent » et ceux qui méprisent. Cette dernière attitude est associée de leur point de vue ( = des gilets jaunes) à un éloignement social. Ce qui est assez juste je crois, car les prises de position méprisantes à l’égard des gilets jaunes émanent de personnes appartenant aux classes dominantes ou, du moins, qui sont très peu en contact avec les milieux sociaux auxquels les « gilets jaunes » appartiennent. »
Certains commentateurs ont évoqué mai 68, mais je pense qu’il n’y a pas tant de ressemblances que cela. Mai 68 restait une révolte des milieux relativement aisés : les étudiants. Je citerais plutôt les grèves des cheminots en 1995 en France, qui mettaient déjà en jeu cette opposition entre une élite « qui sait mieux » et le peuple.
La violence, les casseurs…
Et puis, il n’y a pas que le fond, il y a la forme aussi : les blocages de ronds-points, ce côté piquet de grève devant l’usine, tellement « prolo », et ces violences de fin de match de foot.
Vous voyez, parce que l’élite intellectuelle a aussi une idée de la manière correcte de montrer sa colère. Ça me rappelle ce passage de Sartre se moquant des réactions gênées de la gauche métropolitaine face à la violence des colonisés dans sa fameuse préface des « Damnés de la terre » de Frantz Fanon. Sartre faisait dire à cette gauche : « Vous allez trop fort, nous ne vous soutiendrons plus », et il disait qu’elle pouvait « tout aussi bien se mettre [ce soutien] au cul » (oui, oui, Sartre parlait parfois aussi comme ça !).

Cette opposition ne s’est jamais aussi bien vue que dans le contraste avec la Marche pour le climat, à Bruxelles, le 2 décembre : 70.000 personnes qui défilent, sur un mode de manifestation très classique, sans la moindre violence.
Evidemment, cette comparaison entre une manifestation de personnes se mobilisant pour le climat et les violences des gilets jaunes sur les champs Elysées, ne pouvait se faire qu’au prix d’un double oubli : d’une part quant à la différence des milieux sociaux mobilisés, et d’autre part quant à des rapports différents à la nécessité.
Les oppositions classiques entre les groupes dominants et dominés étaient toutes là :
- Ordre v/s Désordre
- Pacifisme v/s Violence
- Espoir v/s Désespoir
- Manifestation v/s Révolte
- Demain v/s Maintenant
Comme l’explique très bien l’historienne Danielle Tartakowsky,
« la révolte se caractérise par le ‘ici et maintenant’ : dans l’ancien régime, on a faim, on brise les portes des boulangeries, et on mange le pain car on est dans l’urgence. On retrouve aujourd’hui cette urgence, mais uniquement dans les énoncés ».
Toujours ce rapport différent à la nécessité, à l’urgence (de la fin de mois difficile, de la dette à rembourser, de l’emploi à retrouver, des enfants à nourrir). Je m’avance peut-être un peu mais j’aurais tendance à penser que si les ours polaires pouvaient se mobiliser eux-mêmes pour le climat, leur mobilisation ressemblerait probablement plus à celle des gilets jaunes qu’à celle de la marche pour le climat. Ce rapport différent à la survie.
… D’ailleurs, les violences des gilets jaunes ont amené le gouvernement français à retarder une nouvelle vague d’imposition, alors que le lendemain de la marche pour le climat en Belgique, le gouvernement belge a pris des décisions totalement contraires aux revendications des 70.000 manifestants (voir ici la réaction de Bouli Lanners).
Pour autant, la violence envers les policiers n’a aucun sens. Je suis convaincu que les policiers représentent une des catégories professionnelles les plus critiques envers les gouvernements actuels. L’impression que celles et ceux qui décident n’ont aucune connaissance des réalités du terrain, de la rue, est très présente au sein de la police. La différence entre les gilets jaunes et les « casseurs », c’est, je crois, que les gilets jaunes ont compris que les policiers devant eux sont des pères (et des mères) de famille, qui font leur boulot, et qui ne méritent pas de se prendre un pavé ou une boule de pétanque dans la gueule, ce qui pourrait gravement les handicaper. L’un des enjeux de la situation actuelle sera de rassembler policiers et citoyens dans un même mouvement. Pour rappel, la police reste une des institutions dans laquelle la population a le plus confiance (73%, selon le baromètre CEVIPOF).

« Ces beaufs qui ne veulent pas payer d’impôts »
En France, l’ « Observatoire des Inégalités » a très bien fait de rappeler que « l’élite du pouvoir française n’a pas compris un principe de base du consentement à l’impôt : la justice fiscale ».
En France comme en Belgique, des réformes récentes en matière d’impôts ont profité davantage aux plus aisés. 5 milliards de baisse d’impôts pour les plus aisés en France, alors que cela ne concerne que quelques milliers de foyers. A côté de cela, la diminution des cotisations sociales de la taxe d’habitation (France) ne rapporte rien du tout aux plus pauvres.
Ce n’est pas comme ça que l’impôt est censé fonctionner. L’article 13 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 prévoit que l’imposition soit « également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté ».
Autrement dit, si une modification fiscale fait en sorte que les plus riches vont payer moins d’impôts qu’avant, alors même que les plus pauvres vont payer plus d’impôts, on va dans le mauvais sens.
La démocratie et les mouvements citoyens
Au vu de tout cela, je suis convaincu qu’il n’y AUCUNE RAISON d’opposer la mobilisation des gilets jaunes et les revendications que des groupes citoyens, et en transition, portent depuis quelques années. Il y a un même enjeu, qui est celui de réacquérir de la capacité de décision.

Aujourd’hui, les dirigeants dirigent SANS le peuple (dans le meilleur des cas), quand ce n’est pas CONTRE le peuple (dans le pire des cas), à l’exception, parfois, de très petites échelles, comme au niveau municipal ou communal, où ça peut être différent.
Comme l’a très bien écrit, je trouve, Grégoire Polet, dans Le Soir : la révolte des gilets jaunes est une « révolte du bon sens citoyen de l’Etat contre les arguties politiciennes des gouvernements détachés des réalités d’en bas ».
L’idée centrale de la démocratie, c’est qu’on décide tous ensemble. Et comme ce n’est pas possible de mettre 10 millions de Belges ou 60 millions de Français autour de la table pour discuter et décider, on doit se choisir des représentants. Ça peut être par le vote, mais à l’origine de la démocratie, c’était par le tirage au sort (pour des raisons que j’ai expliquées ici). Quoi qu’il en soit, c’est le peuple qui est souverain en démocratie. C’est lui qui a le pouvoir de décision. En fait, il ne délègue que la gestion de ce pouvoir décisionnel aux élus. Quelle que soit la décision, ça devrait toujours être « comme si » nous décidions tous ensemble, que ce soit le prix de l’essence, la TVA sur l’électricité, ou l’ISF. Si la décision qui est prise par les mandataires est tout à fait différente de celle qui aurait été prise par l’ensemble des mandants s’ils avaient pu décider tous ensemble, c’est qu’il y a un problème.
Et comme c’est le cas. C’est qu’il y a un problème. Un vrai problème de démocratie.
Comme je l’ai dit en commençant, je n’ai aucune idée de sur quoi va déboucher cette mobilisation inédite des gilets jaunes. Mais j’aurais tendance à dire que, comme pour tout, elle deviendra ce que nous en ferons.
La pire chose serait de maintenir une scission, purement liée au milieu social, entre les gilets jaunes et des mouvements citoyens qui ont émergé ces dernières années. Heureusement, ça commence à bouger. Après Quitterie de Villepin (Ma Voix) qui a fait un appel très sensé, c’est au tour maintenant de Cyril Dion, appel relayé par le réseau Transition international, via son fondateur en personne, Rob Hopkins !

Il faut être concret, lorsqu’un système s’effondre, soit c’est le chaos (pensons à ce qu’il s’est passé dans certains pays arabes), soit il y a une structure naissante qui est capable de prendre le relai (pensons à la chute du communisme dans nombreux pays de l’ex-bloc de l’Est : Solidarność en Pologne, la « Charte 77 » en Tchécoslovaquie, etc.).
Toutes les listes citoyennes peuvent clairement jouer ce rôle de structures naissantes, capables d’éviter le chaos. Une innovation démocratique s’y est développée, d’autres modèles de prise de décisions, plus démocratiques, sont déjà en vigueur. Quand le modèle politique actuel chutera (ce qui semble plus éminent que jamais), ces mouvements citoyens ont déjà une alternative à proposer.
En particulier, je conseillerais aux gilets jaunes de ne pas tomber dans le jeu de la délégation, qui est le principe central du modèle dont ils expriment leur ras-le-bol.
- S’il y a besoin de leaders => tirons-les au sort, et changeons-en le plus souvent possible, qu’aucun ne puisse s’installer dans cette fonction consistant à parler à la place des autres. Est-ce qu’il n’y a pas un informaticien qui pourrait créer un système où chaque citoyen volontaire pourrait manifester son souhait de se représenter, et à partir duquel un tirage au sort serait effectué ? (ce ne serait qu’une version informatique de ce qui se faisait chaque jour à Athènes grâce au klèrôtérion, la « machine à tirer au sort »).
- S’il faut créer des assemblées => qu’elles restent les plus locales possibles. Tous les mouvements bottom-up doivent se construire sur des bases « d’en bas » : en 1871, la Commune de Paris s’est construite sur les comités de quartier ; la révolution russe s’est construite sur des comités territoriaux et professionnels (comités de fabrique), etc.
Il y a quelque chose qui unit, au-delà des différences de milieux sociaux, toutes celles et ceux qui, aujourd’hui, se mobilisent pour reprendre les choses en main, pour réacquérir du pouvoir de décision, que ce soit au niveau politique, économique, environnemental, alimentaire, social, etc. On sent qu’on va droit dans le mur, il faut qu’on arrive, ensemble, à freiner et/ou à changer de direction, avant qu’il ne soit trop tard.
Je conclurais avec deux citations de Bourdieu :
« Le pouvoir de penser la société, de changer la société, ne se délègue pas, et surtout pas à un Etat qui se donne le droit de faire le bonheur des citoyens sans eux, voire malgré eux ».
et
« La dernière révolution politique, la révolution contre la cléricature politique, et contre l’usurpation qui est inscrite à l’état potentiel dans la délégation, reste toujours à faire ». (1984 :279)
Et si c’était maintenant ? Qui me suit ?
Références :
- Bourdieu, P. 1979. La distinction. Critique sociale du jugement. Paris : Editions de Minuit.
- Bourdieu, P. 1984. “La délégation et le fétichisme politique”, in Langage et pouvoir symbolique, Paris : Seuil, 2001, pp. 259-279.
- Sartre, J.P. 1961. Préface à l’édition de 1961, in Fanon, F. 2002, Les damnés de la terre, Paris : La Découverte, pp. 17-36.