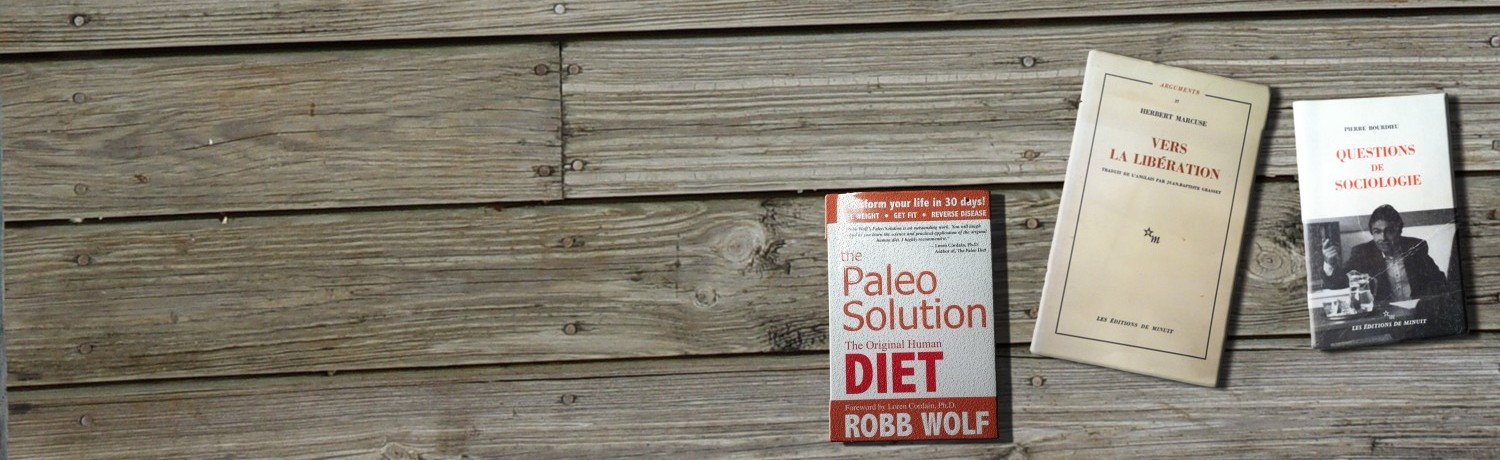Il faut aller de l’avant. Si on veut aller vers un nouveau modèle de société, il faut passer par cette étape de construction théorique, de “conceptualisation”, d’un nouveau paradigme. On ne peut pas simplement répéter qu’il faut que ça change, sans rien proposer, et en espérant qu’un nouveau modèle de société se construise, par lui-même, devant nos yeux. L’ “empowerment”, c’est aussi reprendre en main cette capacité à penser notre société, à proposer quelque chose de nouveau, d’innovant.
Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il faut réinventer la roue. Aucune société n’a jamais été pensée sans lien avec son passé. On ne pourra construire un nouveau modèle de société qu’en l’inscrivant dans une histoire. De nombreux défis auxquels nous faisons face aujourd’hui se sont déjà posés, à des époques antérieures, et il est intéressant d’observer la manière dont nous avons tenté d’y répondre, à l’époque. Avec quels concepts ? Quels outils ? Et dans quel but ?
Parmi les concepts intéressants, il y a celui de “communs”. On en parle assez bien actuellement. Mais je ne suis pas sûr que toutes celles et ceux qui en parlent se soient réellement plongés dans la littérature sur cette question. D’où l’objet de ce texte.
Personnellement, je suis convaincu que cette notion de “communs” doit être utilisée pour aborder à l’avenir les questions environnementales, l’aménagement du territoire, la mobilité, l’économie locale et circulaire, les énergies renouvelables, et tout un ensemble de questions actuelles.
Un prix Nobel d’Économie
En 2009, Elinor Ostrom (1933-2012), politologue et économiste américaine, reçoit le prix Nobel d’Économie pour son travail sur les “communs”, qu’elle définit comme une ressource naturelle ou non-naturelle dont l’utilisation peut profiter à une population définie. Cette ressource est même parfois le principal moyen de subsistance de cette population. Ça peut être le poisson disponible dans une zone de pêche définie, l’eau d’une rivière ou de nappes phréatiques utilisée pour irriguer des cultures, des pâturages que se partagent des bergers pour laisser paître leur troupeau, mais également des ponts nécessaires au transport de marchandises, des places de parking dans une zone déterminée, etc. (Ostrom, 2018).
On l’imagine tout de suite, le risque principal est que certains s’approprient cette ressource au détriment des autres : un pêcheur qui pêcherait tout le poisson de la zone de pêche, un agriculteur qui s’approprierait toute l’eau des canaux d’irrigation, etc. Plus encore, si toutes les personnes concernées essayent de s’approprier un maximum d’unités de la ressource (nombre de poissons, m3 d’eau, etc.), la ressource s’appauvrira… au point d’être détruite et de ne plus pouvoir profiter à personne. Ce risque a un nom : c’est la “tragédie des communs”.
L’histoire de cette tragédie
Et là, il faut faire un peu d’histoire pour comprendre. Le terme vient d’un article de Garrett Hardin, intitulé “The Tragedy of the Commons”, publié en 1968 dans la revue “Science”. Je me base sur sa réédition, en 2001, dans la revue “The Social Contract”.
Hardin (1915-2003) était un philosophe écologiste américain. En 1968, sa préoccupation première est la croissance de la population et son impact sur la planète. L’article propose essentiellement une réflexion théorique sur l’opposition entre une population qui croît indéfiniment dans un monde qui est, lui, fini.
Il faut savoir que la “tragédie des communs” d’Hardin s’inspire directement des lectures de William Forster Lloyd, en 1832. Des lectures publiées en 1833 sous le titre “Two lectures on the Checks to Population”. Elles sont republiées en 1980 dans la revue “Population Council”. Lloyd (1794-1852) était un mathématicien et économiste britannique, mais également Ministre de l’Église d’Angleterre. Et il tenait une Chaire d’économie politique à l’Université d’Oxford.
Dans ses deux lectures, Lloyd imagine cette situation souvent citée lorsqu’on parle des “communs” : un pâturage partagé par un ensemble de bergers, afin d’y laisser paître leurs troupeaux. Chaque berger doit décider s’il rajoute un mouton par exemple, dans son troupeau. S’il le fait, il en retire un gain personnel (un mouton de plus à revendre). La perte due à l’herbe que ce mouton va manger est par contre partagée par l’ensemble des troupeaux. Ça fait un peu moins d’herbe pour l’ensemble des moutons de l’ensemble des bergers. Hardin résumera cela, un peu plus de 100 ans plus tard, avec cette formule : le gain pour le berger est égal à +1, alors qu’il ne subit qu’une fraction de la perte, c’est-à-dire une fraction de -1. Le plus rationnel pour lui est donc de rajouter un mouton de plus à son troupeau. Et puis 2 moutons, puis 3, puis 4… et tous les autres bergers ont intérêt à faire de même. Jusqu’à… la tragédie ! Il n’y aura plus assez d’herbe pour nourrir tous les moutons. Hardin (2001 : 29) conclut : “chaque berger est enfermé dans un système qui l’encourage à augmenter son troupeau sans limite, dans un monde qui est limité“. Il rajoute “la liberté dans un commun amène la ruine de tous“.

Mais pour Hardin, comme pour Lloyd un siècle plus tôt, les pâturages ne sont qu’un prétexte pour parler d’un problème plus large : la croissance de la population dans un monde limité. Lloyd cite très abondamment Malthus (1766-1834), dont il était un contemporain, et qui avait publié son “Essay on the Principle of Population” en 1798. Malthus a laissé son nom au “malthusianisme”, un courant de pensée prônant le contrôle des naissances. Et Lloyd comme Hardin, inscrivent la tragédie des communs dans la pensée malthusienne. Pour Hardin, tout comme le berger faisant paître trop de moutons par rapport à ce que le pâturage peut supporter met en danger ce pâturage “commun”, les parents qui ont “trop” d’enfant mettent en danger notre monde “commun”. Le problème est la “sur-reproduction” (“overbreeding”). On est en 1968, en plein baby-boom de l’après-guerre. Et il faut selon Hardin, “abandonner la liberté de se reproduire“, c’est-à-dire qu’il faut instituer une politique de contrôle des naissances.
Ce détour historique montre que cette idée de “tragédie des communs” s’inscrit avant tout dans une réflexion malthusienne. Ça ne la discrédite pas directement, bien que le contrôle des naissances ne soit plus tout à fait à l’ordre du jour, du moins en Occident. Par contre, cette idée qu’il est impossible de croître indéfiniment dans un monde fini est tout à fait d’actualité. Nous n’avons peut-être pas de plus en plus d’enfants, mais nous avons de plus en plus de voitures, par exemple. En posant le problème dans les mêmes termes, on retombe donc tout de suite sur le problème de la mobilité dans nos villes : peut-on indéfiniment augmenter le nombre de voitures sans congestionner complètement nos villes ? La tragédie est la même : chacun est encouragé à prendre sa voiture parce que « ça va plus vite », sauf que si tout le monde le fait, on reste bloqué des heures dans les embouteillages… et ça ne va pas du tout plus vite. La ressource partagée (les voies publiques de circulation) est détruite puisqu’on ne peut plus y circuler.
Le dilemme du prisonnier
C’est de ce problème, de cette tragédie, que part Elinor Ostrom, dans ses travaux qui lui vaudront le prix Nobel 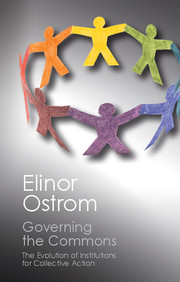 d’Économie, en 2009. Et elle y rajoute l’apport du “dilemme du prisonnier”, en théorie des jeux.
d’Économie, en 2009. Et elle y rajoute l’apport du “dilemme du prisonnier”, en théorie des jeux.
Le dilemme du prisonnier est généralement formulé comme ceci : deux prisonniers qui ont commis ensemble un délit sont arrêtés et placés dans des cellules séparées sans moyen de communication entre eux.
- Si l’un des deux prisonniers dénonce l’autre, il sera libre et l’autre écopera de la peine maximale (10 ans par exemple) ;
- Si les deux prisonniers se dénoncent l’un l’autre, ils seront tous deux condamnés à une peine moyenne (5 ans par exemple) ;
- Si aucun des deux prisonniers ne dénonce l’autre, la peine sera minimale (1 an par exemple)
Comme on le voit, la “meilleure solution” pour les deux prisonniers serait de se taire (1 an de prison chacun). Mais comme aucun des deux prisonniers ne peut savoir ce que va faire l’autre, et que l’autre risque, lui, de dénoncer, il est fort probable que ces prisonniers choisiront de dénoncer, et écoperont donc chacun de 5 ans de prison. Autrement dit, la solution la plus rationnelle au niveau individuel (dans le doute, dénoncer l’autre) est la plus mauvaise au niveau collectif.
Et comme nous l’avons vu, il en va de même pour les bergers des pâturages communs : leur choix de rajouter des moutons à leur troupeau est rationnel individuellement, mais “tragique” au niveau collectif. Ce dilemme du prisonnier peut laisser penser qu’il est impossible, pour des êtres rationnels, de coopérer (Campbell, 1985 :3).
Revenons à du concret…
Derrière le dilemme du prisonnier et la tragédie des communs de Hardin, il y a une figure : le “free rider“, qu’on pourrait traduire en français par “celui (ou celle) qui fait cavalier seul”, c’est-à-dire celui ou celle qui va profiter de la ressource commune, en maximisant son propre profit, au détriment des autres.
La plupart des réflexions sur les comportements écologiques vont aboutir à cette figure du “free rider”, comme je l’avais moi-même expliqué dans un article de 2010, intitulé “Comment enseigner les comportements écologiques ? L’expérience du ‘dilemme du prisonnier’” (Patte, 2010). Ainsi, l’opinion “Pourquoi je ne dénoncerais pas l’autre prisonnier, si j’anticipe le fait que cet autre prisonnier va me dénoncer” devient, en termes de comportements écologiques : pourquoi devrais-je faire un effort si j’anticipe le fait que les autres n’en feront pas ? On l’a déjà toutes et tous entendu, cet argument, non ? Pourquoi est-ce que je me passerais de ma voiture si d’autres prennent l’avion trois fois par an ?

C’est que l’inverse de la figure du “free rider” est la figure du “double perdant“. Et personne ne veut être le “double perdant” : celui ou celle qui fait un effort, mais qui subit quand même les conséquences du manque d’effort des autres. Exemple : le berger qui ne rajoute pas de mouton à son troupeau pour préserver les pâturages, mais qui subit quand même la dégradation des pâturages, parce que les autres bergers ne se sont pas restreints comme lui. Il est doublement perdant.
Historiquement, ce problème a trouvé deux réponses, et on va voir tout de suite à quoi ça se rapporte dans nos sociétés actuelles. Ces deux réponse sont : une autorité publique qui gère la ressource commune, ou la privatisation de cette ressource. Dans le premier cas, une autorité centrale (agence publique, gouvernement, autorité internationale) va réguler ce qui peut être consommé (ex. : quota de pêche, taille des troupeaux, m3 d’eau puisés, etc.). Le contrôle est lui-même centralisé et relève du monopole de cette autorité. Il faut alors faire l’hypothèse que cette autorité centrale connaît la durabilité de la ressource, et peut prévoir son renouvellement. Et c’est seulement dans ce cas-là qu’un équilibre peut être atteint. Mais si cette autorité se trompe, si elle n’a pas toutes les informations nécessaires, si elle contrôle mal, les risques sont d’une part que la ressource soit épuisée, et d’autre part que ça devienne plus intéressant pour les individus de frauder.
Il y a donc une alternative : privatiser la ressource. On rejoue le mouvement des enclosures du 16ème siècle : on coupe le “commun” en parcelles privées. Dans l’exemple du pâturage, chacun peut laisser paître ses moutons dans sa parcelle.
Evidemment, rien n’indique qu’on s’approche davantage d’un optimum au niveau de l’utilisation de la ressource. Peut-être qu’une parcelle subira des intempéries, dégradant l’herbe et empêchant le troupeau d’y paître, alors qu’une parcelle plus loin aura davantage d’herbe que ce dont le troupeau a besoin. Bref, rien ne dit que la privatisation permettra une meilleure allocation des ressources au niveau de l’ensemble. Et lorsque la ressource ne peut pas être divisée en parcelles, comme l’air, l’eau, etc., la privatisation est tout simplement impossible.
Ces deux solutions ont par ailleurs ceci en commun : toutes deux impliquent un État fort qui, soit régule la ressource, soit crée la parcellisation de la ressource, et les décisions s’imposent aux personnes concernées de l’extérieur (hétéronomie).
La gestion des “communs”
Il y a pourtant un autre modèle, et c’est là tout l’apport d’Ostrom. A différents endroits du monde, des ressources communes sont gérées de manière autonome (donc sans autorité externe) par celles et ceux qui les utilisent. Ostrom a ainsi analysé les caractéristiques de ces “Common-pool resources” (CPR), et parmi ceux-ci, on trouve : les prairies et forêts de Törbel en Suisse, et des villages de Hirano, Nagaike et Yamanoka au Japon, et l’irrigation des cultures partagées à Valence, Murcia, Orihuela et Alicante en Espagne, et à Ilocos Norte aux Philippines.
Alors, qu’est-ce qu’on peut retirer du modèle des “communs” d’Ostrom pour proposer des pistes de construction d’un modèle de société plus efficient que le modèle actuel ?
-
L’échelle locale.
Ces ressources communes sont bien évidemment naturellement liées à un territoire, mais ce qui est original, c’est que la gestion est elle-même relocalisée sur ce territoire. Par conséquent, ce sont celles et ceux qui sont directement concernés par cette ressource qui vont fixer les règles et le contrôle de son utilisation.
Voilà un système qui intègre la dimension “Skin in the game”, dont parle Taleb (2017). Les pêcheurs, les bergers, les cultivateurs observés par Ostrom ont besoin de cette ressource pour survivre et faire vivre leur famille. Ils ne peuvent donc pas épuiser cette ressource. Ostrom remarque d’ailleurs que les “locaux” vont davantage se projeter dans le futur. Ainsi les pêcheurs locaux, par exemple, veulent encore pouvoir pêcher au même endroit, c’est-à-dire où ils vivent, dans 10 ans. Et même plus loin : ils veulent que leurs enfants et petits-enfants puissent encore pêcher au même endroit (Ostrom, 2018 : 35). A l’inverse, des pêcheurs qui pêchent loin de chez eux vont avoir davantage tendance à se servir tant qu’il y en a, puisqu’ils savent qu’ils pourront aller pêcher ailleurs lorsque la ressource sera épuisée. Un “commun” est donc d’autant mieux géré que celles et ceux qui en ont la charge y sont liés. Leur survie en dépend.

De là découle le fait qu’il importe de définir la bonne échelle. Une échelle qui reste locale et qui permet que les différents utilisateurs, qu’Ostrom appelle “appropriators”, restent connectés les uns aux autres : “l’élément clé de la vie des co-appropriators est qu’ils soient liés les uns aux autres dans un maillage d’interdépendances, tant qu’ils continuent à partager un même CPR” (Ostrom, 2018 : 38). Cela renvoie également à l’idée de “réputation” : les personnes impliquées ont partagé un passé et espèrent partager un futur. Il est donc important pour eux de maintenir une bonne réputation. Ils vivent les uns à côté des autres et s’attendent à ce que leurs petits-enfants héritent de leurs terres. L’ancrage territorial s’inscrit dans le temps comme dans l’espace. Les “communs” étudiés par Ostrom rassemblent de 50 à 15.000 personnes, et elle observe qu’une échelle trop grande est une cause d’échecs de certains communs. Cela est entre autres dû à un manque d’attachements entre les appropriators. Le premier principe de longévité d’un CPR pour Ostrom est le fait qu’il ait des frontières bien définies. On sait sur quel territoire il s’étend, et qui utilise la ressource.
-
La survie malgré des environnements complexes
Les “communs” d’Ostrom ont une longévité que beaucoup d’institutions envieraient, puisque certains remontent aux 17ème siècle (Japon), et même au 13ème siècle (Suisse). Cela est dû au fait que ces “communs” sont tout à fait adaptés aux environnements complexes et incertains auxquels ils font face. Chacun des “communs” étudiés a d’ailleurs ses règles propres, et celles-ci se sont construites, dans la pratique, par essais et erreurs. Comme ce sont celles et ceux qui utilisent la ressource qui en fixent les règles d’utilisation, ils ont pu constamment adapter les règles aux circonstances : “les individus qui interagissent directement entre eux et avec le monde physique peuvent modifier les règles au fil du temps, afin de mieux les adapter aux caractéristiques spécifiques du dispositif” (Ostrom, 2018 : 93).
Les règles sont là pour répondre aux problèmes spécifiques et uniquement pour cela. Ainsi, dans le cas des systèmes d’irrigation aux Philippines, lorsqu’il y a assez d’eau, tout le monde peut se servir. Il n’y a pas de règles. Ce n’est que lorsque l’eau se fait rare qu’un système de rotation est mis en place.
-
L’autogestion
Comme on le voit, cette adaptation constante aux circonstances est possible parce que les décisions se fondent sur l’ “expérience de terrain” (“on-site experience”), par les personnes concernées elles-mêmes, sans devoir faire appel à une autorité extérieure : “les usagers/propriétaires sont l’unité décisionnelle“, dit Ostrom (2018 : 61). Les règles sont fixées par les usagers, et le contrôle se fait également par eux-mêmes. Les sanctions se font par les pairs. Ostrom insiste sur ce fait qu’il n’y a pas besoin qu’une force coercitive extérieure soit présente pour qu’un “commun” soit géré de manière très efficiente.
C’est finalement assez simple : celles et ceux qui trichent sont repérés par celles et ceux qui sont directement lésés. Et inversement, les droits de chacun sont défendus par les autres : je ne veux pas qu’un autre soit lésé, parce que je ne veux pas moi-même être lésé.
-
Une dévolution du pouvoir
Cette gestion du “commun” ne se fait pas dans un vide institutionnel et législatif. Comme l’a remarqué Ostrom, il est important que les gouvernements externes reconnaissent la légitimité des règles du “commun”. Il ne doit pas être possible, pour un usager, de contourner les règles du “commun” en se référant à une autorité supérieure (Ostrom, 2018 : 101). Dans certains des cas étudiés, la législation nationale donne à la coopérative de gestion du “commun”, la juridiction sur ces arrangements locaux.
-
Une reconnaissance de la capacité d’auto-organisation
Un élément extrêmement important du travail d’Elinor Ostrom – et qui m’intéresse tout particulièrement – est cette reconnaissance de la capacité d’une population déterminée à s’auto-organiser, sans intervention extérieure.
Les deux modèles classiques que sont un Etat fort ou la privatisation postulent finalement que les individus ne pourront pas s’organiser entre eux. Il faut donc soit une autorité extérieure, au-dessus, qui fixe les règles, qui contrôle et qui sanctionne, soit une privatisation qui renvoie chacun chez soi et nul besoin de s’organiser. Ce qui est original avec les “communs”, c’est de présenter des exemples d’auto-organisation. Et c’est extrêmement important, puisque la démocratie repose sur cette conviction que les individus, dans les bonnes conditions, pourront gérer ensemble la Chose publique.
Pour aller plus loin…
Si on se résume, ce modèle des “communs” d’Ostrom invite à penser la société à venir comme construite par le bas, par les acteurs de terrain, c’est-à-dire celles et ceux qui sont directement concernés. On est en plein dans une dynamique d’ “empowerment”, de reprise en main de leurs ressources par les communautés locales.
Il est très intéressant de remarquer que cette notion de “communs” retrouve de l’intérêt à une période où à la fois le “tout à la privatisation” et le “tout à l’État” montrent leurs limites. De plus, ce modèle lance un nombre important de pistes en matière d’environnement, d’aménagement du territoire, de ruralité, d’énergies renouvelables, d’économie locale, etc.
Un quartier peut être approché comme un “commun”. Le centre d’une petite ville de province peut être approché comme un “commun” : comment gérons-nous en commun l’utilisation d’une ressource que serait son accès ? Si chacun s’y rend en voiture, il y a une congestion, plus personne ne trouve de places de parking, et petit à petit plus personne n’y va. Le centre-ville périt, les commerces ferment. Le modèle d’Ostrom invite à une gestion reconnue par les autorités de la Ville, mais impliquant les habitants et les commerçants, c’est-à-dire celles et ceux qui sont principalement concernés.

On pourrait prendre des exemples avec les énergies renouvelables : comment gérer en commun une ressource locale que serait un terrain suffisamment exposé aux vents, ou au soleil, pour y installer un parc éolien ou photovoltaïque ? Le modèle des “communs” invite à gérer cela au niveau local en impliquant celles et ceux qui vont non seulement partager les bénéfices d’avoir une énergie locale disponible, mais également les nuisances éventuellement occasionnées. Il n’y a pas de raisons que certains jouent les free-riders en profitant d’installations productrices d’énergie implantés loin de chez eux, et en ne subissant donc aucune des nuisances, alors que d’autres auront peut-être les nuisances sans pouvoir profiter de l’énergie (les “double perdants” du dilemme du prisonnier).
Et on pourrait comme ça multiplier les exemples. Je suis vraiment convaincu que ce modèle des “communs” doit être un élément important d’un nouveau modèle de société, post-industriel.
Si cette question des communs vous parle et que vous avez envie de m’aider à construire quelque chose par rapport à ça, n’hésitez pas à vous manifester.
De mon côté, dans un prochain texte, j’explorerai la manière dont on peut lier les “communs” à une notion finalement assez proche, celle de “Commune”, au sens autogestionnaire du terme, comme quand on se réfère à la Commune de Paris de 1871.
RÉFÉRENCES :
- Campbell, R. 1985. « Background for the Uninitiated », in Campbell, R., &, Sowden, L. (eds), Paradoxes of Rationality and Cooperation, Vancouver : University of British Columbia Press, pp. 3-41.
- Hardin, G. 2001 [1968]. « The Tragedy of the Commons », The Social Contract, vol. 12, n°1, pp. 26-35.
- Lloyd, W.F. 1980 [1833]. « Archives. On the Checks to Population », Population Council, vol. 6, n°3, pp. 473-496.
- Ostrom, E. 2018. Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge : University Press.
- Patte, Y. 2010. « Comment enseigner les comportements écologiques ? L’expérience du ‘dilemme du prisonnier’ », Revue « Imagine », novembre-décembre 2010, pp. 14-15.
- Taleb, N.N. 2017. Jouer sa peau. Asymétries cachées dans la vie quotidienne, Paris : Les Belles Lettres.