
Ce chapitre est une version de travail d’un chapitre du livre en cours d’écriture “Anti-délégation. La société de l’Empowerment”. Je la diffuse pour toute personne intéressée à enrichir la réflexion. Lisez, commentez, partagez, discutONS-en, discutEZ-en.. Que toute personne intéressée à participer à la réflexion se sente autorisée à le faire !!
- Vous trouverez ici l’introduction à l’ouvrage
- Vous trouverez ici une version pdf de l’article ci-dessous (28 pages)
- Vous pourrez lire, sur le site de WeDemain, une bonne introduction au point de vue adopté ici…
UPDATE (27 avril 2016) : Cet article a reçu des retours très positifs de deux spécialistes français du terrorisme : Gilles Kepel et Olivier Roy, sans même que je ne les sollicite. Gilles Kepel m’a d’ailleurs proposé de rencontrer son collaborateur, Hugo Micheron, chercheur français, spécialiste du jihadisme, au Centre de recherches internationales (Ceri), à Science-Po.

——————————- Début de l’article ——————————-
“Quand l’intérêt général s’en va, arrive le trader suivi du gourou. Quand l’Etat s’effondre, restent deux gagnants : les sectes et les mafias. Les banquiers d’affaires d’un côté et les hallucinés de l’autre. Quand l’idée de service est ridiculisée, ne reste plus qu’à se servir soi-même. Le cynisme engendre à la fois le fanatisme et la tricherie.” Régis Debray (2015 :17)
“Que cherchent tous ces jeunes à la dérive qui se suicident à l’aide d’un islam extrême ou à coups de canettes de bière suralcoolisées et de spliffs dix fois trop chargés ?” Abd al Malik (2004 :128-129)
Il est toujours plus facile d’avoir la mémoire courte. Les attentats récents en Europe mettent au devant de la scène, le phénomène de la radicalisation religieuse. D’un coup, on se rend compte que des jeunes sont prêts à aller mourir pour la cause djihadiste. Et des jeunes « de chez nous » – pas des jeunes Afghans formés dans d’obscures écoles coraniques pakistanaises. Non, des jeunes de nos quartiers, de nos banlieues, qui ont été dans nos écoles. Dans nos prisons aussi.
Tout autant qu’on est surpris que des jeunes puissent adopter une vision fondamentaliste de la religion musulmane, telle que le salafisme, on se surprend de voir d’autres jeunes embrasser le nationalisme et rejoindre les mouvements d’extrême-droite.
Oui, dans la deuxième décennie du 21ème siècle, des jeunes sont salafistes, des jeunes sont d’extrême-droite, des jeunes sont contre les droits de la femme, des jeunes sont racistes, antisémites, islamophobes, homophobes, etc. Mais ça n’est probablement pas arrivé du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin avec des vidéos djihadistes qui cartonnent sur Youtube et PEGIDA qui rassemble des milliers de personnes dans des manifestations islamophobes.
Je crois qu’il faut replacer l’émergence de ces phénomènes dans des processus sociaux plus longs. Le profil des jeunes français et belges, qui sont partis en Syrie, dont ceux qui ont commis les attentats à Charlie Hebdo en janvier 2015, dans les rues de Paris en novembre 2015 et à Bruxelles en mars 2016, invite à replacer la radicalisation dans l’histoire des populations et des quartiers dont ils provenaient. Les explosions de violence en banlieue en France, ou dans certains quartiers de Molenbeek en Belgique, ne sont pas récentes. Les jeunes qui n’arrivent plus à se construire une identité, du moins positive, ça n’est pas récent non plus. Et on a eu tout le temps de voir l’islam évoluer depuis les premières communautés immigrées en Europe de l’Ouest jusqu’à aujourd’hui.
Une double histoire est nécessaire : celle des quartiers/villes d’où proviennent les jeunes attirés par le djihadisme ou le nationalisme, et une histoire du rapport à l’islam.
Pour cela, première précaution : ne pas tomber dans une approche centrée sur la France. Facile à dire évidemment quand on écrit depuis la Belgique. Mais c’est important au niveau de la compréhension même du phénomène. Beaucoup d’auteurs (sociologues, islamologues, etc.) étant Français, l’analyse tourne souvent autour de questions qui structurent le débat français : la République, la laïcité, les banlieues. Pourtant, certains des terroristes de Paris et de Bruxelles vivaient en Belgique : ils n’ont pas été élevés dans les valeurs de la République, ne sont pas passés par l’ « école de la République », et ne se sont pas non plus radicalisés « contre » la République. De plus, ils ne vivaient pas dans une « banlieue », typiquement française, mais dans des quartiers ghettoïsés proches du centre de Bruxelles, comme ceux qui venaient de Molenbeek.
Cela invite donc à ouvrir la problématique à des phénomènes qui dépassent souvent les frontières. Tout ce qu’on lit sur « la République » peut être correct, mais c’est à mon sens, la traduction française de phénomènes sociaux plus larges, dont la crise de la délégation que j’essaie de décrire ici.
1. Des émeutes au djihad
1.1 La construction du « problème des banlieues »
Directement en lien avec le fait de ne pas faire du « Franco-centrisme », il y a le « problème des banlieues ». Beaucoup de candidats français au djihad proviennent des « banlieues ». Mais ils sont connectés, comme les enquêtes l’ont montré, avec des jeunes bruxellois qu’on ne peut pas réellement appeler des « jeunes de banlieue », tant la structuration « centre-ville aisé / périphérie pauvre » n’existe pas en Belgique. La France a découvert Molenbeek : une commune pauvre de Bruxelles (en fait la deuxième commune la plus pauvre de Belgique), très proche du centre au niveau géographique, mais dont certains quartiers sont totalement ghettoïsés par rapport au reste de la ville.
C’est pourquoi je parlerai plutôt de quartiers « ghettoïsés ». Jacinthe Mazzocchetti (2012 : 2), qui bossait dans la même unité de sociologie que moi à l’époque, a une définition très intéressante de ces quartiers. Ils sont le résultat, dit-elle, de l’enfermement des immigrés (et de leurs descendants) dans certains quartiers, via le marché du logement, les discriminations rencontrées en milieu scolaire et les discriminations sur le marché du travail. Cette définition me semble plus efficace pour aborder les lieux d’origine de beaucoup de jeunes djihadistes, que ce soit en Belgique (sa recherche portait entre autres sur des quartiers de Molenbeek), en France (les « banlieues ») ou dans d’autres quartiers en Europe ou aux Etats-Unis (comme nous le verrons dans le New Jersey ou à Philadelphie).
D’autant plus que Mazzocchetti (2012 :2) rajoute une dimension importante : le rejet va dans les deux sens. La ghettoïsation est aussi un mouvement qui vient de l’intérieur des quartiers relégués : les acteurs marginalisés s’organisent, autour de solidarités ethniques. Mais cet « entre soi », conséquence d’un sentiment d’être exclu du reste de la société, rajoute encore à l’exclusion.
Encore une précaution, il ne s’agit en aucun cas de stigmatiser toute la population de ces quartiers. Je parlerai souvent de Molenbeek, d’Anderlecht, de Clichy-sous-Bois ou des Minguettes, mais je me garderai bien de prétendre que ces communes ou ces quartiers se réduisent à ce que j’en décris. Il y a plein d’habitants de ces lieux qui sont engagés dans des dynamiques très positives, ou d’autres qui ne font rien de spécial, à part subir les méfaits d’une minorité. L’empowerment passe aussi par le fait de laisser aux communautés le pouvoir de se définir elles-mêmes. Je ne voudrais pas les en désapproprier. Je décris la radicalisation d’une minorité d’habitants de ces lieux.
Les premières fois où ces quartiers « en voie » de ghettoïsation (à l’époque) font parler d’eux remontent au début des années 80. Mon historique se basera sur un article d’Annie Collovald (2000), définissant trois périodes de 1981 à 1998 dans le traitement médiatique et politique du « malaise des banlieues », et j’y rajouterai les faits belges qui, malgré qu’ils ne se déroulent pas en banlieue, confirment le phénomène de radicalisation dans les quartiers ghettoïsés.
1981 est l’année des premiers incidents marquants en France et en Angleterre, avec les « rodéos » des Minguettes, dans la banlieue lyonnaise et les émeutes raciales de Brixton, dans le sud de Londres. En réalité, la banlieue de Lyon avait déjà connu des incidents, dès le début des années 70, mais cela restait plus circonscrit, et surtout, ces événements étaient interprétés comme des débordements typiques des quartiers populaires.
A partir de cette année 1981, la cadre d’interprétation des événements se construit sur le triptyque : banlieue – immigration – violence (Collovald, 2000 :40). On parlera désormais du « malaise des banlieues », des « populations immigrées » et des « violences urbaines ». Deux ans plus tard, en 1983, la « Marche des Beurs », appelée initialement « Marche pour l’égalité et contre le racisme », toujours à la suite d’événements violents, dans le quartier des Minguettes, s’inscrit dans ce cadrage des événements. A gauche, on parle d’un problème d’intégration ; à droite, d’un problème d’immigration.
En 1990, les « échauffourées » de Vaulx-en-Velin, toujours en banlieue lyonnaise, font suite à la mort d’un jeune du quartier imputée à la Police – comme c’est le cas pour la plupart des éclatements de violence dans ces quartiers –, et remettent la problématique au devant de la scène médiatique.
Durant toute cette décennie, on « ethnicise » le problème – ethnicisation qui deviendra performative. La presse d’extrême-droite parle de « banlieues immigrées », le Nouvel Observateur d’ « Intifada ». Les pouvoirs publics, comme les médias, renvoient les émeutiers à leurs origines immigrées.
Parallèlement, c’est à la même époque qu’apparaissent les premières revendications musulmanes pour la reconnaissance d’une « identité musulmane véritable ». En 1989 éclate la première « affaire du foulard ». En France d’abord, où deux élèves d’un collège de Creil (Oise) se voient interdire le port du voile à l’école. L’affaire se poursuit ensuite, comme une copie, en Belgique, dans une école secondaire de Molenbeek, puis à l’Université. Pour les femmes qui revendiquent le droit de porter le foulard, à l’école ou dans certains lieux spécifiques, « être musulmane en Europe – et être musulmane tout court – passe nécessairement par le port du foulard », explique Dassetto (2012 :12). Malek Boutih, à l’époque vice-président de SOS Racisme, créé dans ce contexte « banlieue – immigration –violence » et à la suite de la Marche des Beurs, prendra la défense de ces jeunes filles et demandera leur réintégration à l’école. Il déclarera, dans Le Monde (7 octobre 1989) : « En aucun cas, une sanction ne peut être infligée à des élèves en vertu de leur foi. » C’est le même Malek Boutih qui, en juin 2015, sera en charge du rapport « Génération radicale » sur les phénomènes de radicalisation et le djihadisme, pour le ministre de l’Intérieur.
Les événements se poursuivent en banlieue et dans les quartiers en voie de ghettoïsation, durant les années 90, et c’est « la violence » qui s’impose de plus en plus comme « la » catégorie pour penser les jeunes habitants des banlieues (Collovald, 2000 :42). En novembre 1997, éclatent les émeutes de Cureghem, à Bruxelles. Cureghem est un quartier de la commune d’Anderlecht, jouxtant Molenbeek, et présentant de nombreuses caractéristiques sociologiques communes (en sautant un peu dans le temps, c’est dans ce quartier que logeait Mohamed Abrini, impliqué dans les attentats de Paris et de Bruxelles, en 2016, lors de son arrestation). Un jeune dealer du quartier est tué par la police, ce qui déclenche trois jours d’émeutes. On parle à l’époque du chômage, de la pauvreté, du désespoir des jeunes, du décrochage scolaire, etc. Mais la réponse principale est en terme de sécurité : on réfléchit surtout à l’organisation de la police et de la justice. « Prévention » signifie alors « présence policière ». On place des caméras, on crée des « plans de prévention et de sécurité », et le débat public se joue sur la peine à prononcer pour les émeutiers, et à savoir ce qu’il faut faire lorsqu’ils sont mineurs, etc.
« Je sais que si je reste ici plus longtemps, je vais droit en prison. On est obligé de se mettre hors la loi, puisque le système nous abandonne. Je n’attends qu’une chose : partir. Mais pour ça, il faut de l’argent ». Saïd, 20 ans
« Les seuls qui s’occupent vraiment de nous, c’est les policiers. On en a marre de toutes ces caméras, ces grillages, et ces patrouilles. On n’est pas des animaux… Pourquoi on nous met en cage ? », Yessine, 18 ans.
(Tous deux sont interrogés par le journal Le Soir, 7 novembre 1998, un an après les événements)
Des habitantes du quartier (mères, sœurs, épouses) se constituent comme « Citoyennes responsables », et présentent au bourgmestre (équivalent du « maire » en Belgique) un « cahier de doléances » en dix points. On leur promet plein de choses, mais au final, la seule chose qu’on leur propose est que leurs enfants ne reçoivent plus de porc dans les cantines des écoles relevant de la commune. Et des formations sont proposées aux jeunes du quartier comme éboueurs… Ces « citoyennes » restent amères : elles avaient joué le jeu démocratique, dans une démarche citoyenne ; elles en ressortent avec le sentiment de ne pas avoir été écoutées par les pouvoirs publics. En France comme en Belgique, le constat est le même : les années 90 ont été marquées par un fort sentiment d’abandon des habitants à l’égard des pouvoirs publics et de l’Etat (Kokoreff, 2008 :238).
Le milieu des années 90 est également l’époque de l’apparition d’une forme de djihad sur le sol français, avec, en 1995, une série d’attentats revendiqués par le GIA, qui se concluront par la mort de Khaled Kelkal. Celui-ci avait constitué son réseau à partir de Vaulx-en-Velin. Quelles que soient les relations que Kelkal entretenait avec le GIA, les services secrets algériens ou même français, selon certaines interprétations, le fait est que sa radicalisation passera par des propos sur la perdition des musulmans de France, sur ce qu’être un bon musulman, etc. Une ébauche du discours récurrent du Daech aujourd’hui.
A la fin des années 90, ce sont les « experts » qui s’imposent : la « violence urbaine » est un enjeu politique, et menace l’autorité de l’Etat. Les discours centrés sur les problèmes « sociaux », chômage, pauvreté, relégation, etc., en ce y compris le discours des acteurs de terrain, sont écartés au profit des expertises sur l’ « ordre public », la « délinquance », la « violence ». L’enjeu est étatique, les solutions sont technocratiques. Et les populations concernées se voient désappropriées du discours et des moyens d’action sur les réalités qu’elles vivent. Les recherches sur les dynamiques d’empowerment montrent que le langage des professionnels institués provoque la dépendance, le sentiment de perte de contrôle, l’abandon (Lord & Hutchinson, 1993). En 1999, le Ministre belge de la Justice, Marc Verwilghen (Libéral flamand), commande une enquête sur les liens entre criminalité et immigration…
La décennie à venir ne voit pas une diminution des émeutes dans les quartiers. En octobre 2005, Clichy-sous-Bois s’embrase après la mort de deux ados, Bouna Traoré et Zyed Benna, poursuivis par la police, et le jet d’une grenade lacrymogène à l’entrée d’une mosquée, trois jours plus tard. La situation sera telle que l’état d’urgence sera déclaré le 8 novembre, et maintenu durant trois semaines.

Un collectif se crée : AC Le Feu, pour « Association Collectif Liberté, Egalité, Fraternité, Ensemble, Unis ». Ce collectif rencontre les habitants des quartiers de 120 villes de France et récolte leurs constats, demandes et propositions. Il en ressortira un « Cahier de Doléances », remis au Président de l’Assemblée, Jean-Louis Debré, fin 2006. En février 2007, le collectif retente le coup en soumettant un « contrat social et citoyen » aux candidats à la présidentielle. Mohammed Mechmache, président du collectif, présente ce contrat comme une deuxième tentative, après le peu de considération pour le Cahier de Doléances « On attend des présidentiables (…) qu’ils s’engagent. (…) Mais ils devront faire vite cette fois, on n’attendra pas ! » (Le Monde, 23 février 2007).
Dans cette période de technocratisation de la question des émeutes, les démarches « politiques » au sens large du terme, qui viennent de la population et qui remontent vers les dirigeants, n’ont pas de poids, rajoutant au sentiment de ne pas être écouté, au sentiment d’être désapproprié du pouvoir d’agir pour améliorer la situation en banlieue. Ce collectif a joué le jeu de la démocratie, de la République, jusqu’au bout : le nom du collectif renvoie aux valeurs de la France, le préambule se réfère à la Révolution française (« A l’instar des sans culottes de la révolution française de 1789, notre démarche vise à faire remonter l’expression populaire auprès des édiles de la nation. »), ils revendiquent la participation citoyenne comme la meilleure arme pour faire changer les choses… mais la réponse de la République est grosso modo : Toutes nos lignes sont occupées, merci de rappeler plus tard…
Une observation en passant : la religion n’occupe qu’une place restreinte dans les 20.000 témoignages récoltés. Le Cahier de Doléances relève qu’un amalgame nuisible est souvent fait entre islam et terrorisme, que les personnes musulmanes sont davantage victimes de discriminations à l’embauche, et que le nombre insuffisant de mosquées risque d’amener un développement anarchique de salles de prières dans des lieux inadaptés, « ce qui pourrait laisser le champ libre aux mouvements les plus radicaux ». C’est ce que disaient les habitants de banlieues françaises, en 2005. Pour le reste, leurs revendications n’avaient aucun lien avec la religion.
En novembre 2007, des émeutes éclatent à Villiers-le-Bel, en banlieue parisienne. Elles sont déclenchées par la mort de deux adolescents lors d’une collision à moto avec une voiture de police. En 2008, à Anderlecht, en Belgique, ce sont les « émeutes de Saint-Guidon », du nom du quartier où elles se déroulent.
J’étais enseignant à l’époque, précisément à Anderlecht. J’y enseignais le travail social dans la section « technique » d’une école dont la majorité des élèves provenaient des quartiers les moins aisés d’Anderlecht et Molenbeek. J’étais donc aux premières loges, puisque chaque matin, j’avais les récits de mes élèves qui avaient assisté – voire participé – aux émeutes de la veille au soir. D’autant plus que l’un des chapitres de mon cours, avec les élèves de dernière année, était précisément les violences urbaines et les émeutes en banlieue. Nous y analysions les émeutes de 2005 à Clichy-sous-Bois…
Les émeutes d’Anderlecht, en 2008, constituent, à mon sens, une évolution vers une dimension plus « identitaire » de violences urbaines. Elles n’opposaient plus « les jeunes du quartier » et la police, elles opposaient les « Belges de souche » et les « étrangers » (formules que je reprends à la presse de l’époque). Tout démarre en réalité quelques jours auparavant lorsqu’une rumeur circule dans les milieux hooligans du club de foot d’Anderlecht, que trois agresseurs d’origine nord-africaine ont été relâchés après le viol d’une jeune femme. Rumeur fausse puisqu’ils ont été placés en institution, étant mineurs. A cela s’ajoute la rumeur inverse selon laquelle deux « skinheads » auraient frappé une maman marocaine. Les rumeurs se propagent très vite et un appel à la confrontation est relayé sur de nombreux blogs. Le vendredi 23 mai, en fin de journée, les échauffourées débutent, et opposent au final, deux groupes de Bruxellois, les uns s’identifiant comme Belges « de souche », les autres comme « Roloto » ou « Marocains ». Les uns sont venus « casser du bougnoule », les autres « taper du skinhead », selon les termes entendus à l’époque.
Hugues Dorzée, journaliste au Soir (26 mai 2008), écrira : « le caractère raciste et venimeux du conflit ne peut être nié sous aucun prétexte. (…) C’est à Anderlecht que ça se passe. Entre jeunes, tous belges, mais d’origines diverses. Dans une commune multiculturelle à l’image injustement écornée, mais où l’extrême-droite creuse lentement son sillage dans les couches populaires. Entre les ‘natifs’ et les ‘néos’ anderlechtois se dressent, insidieusement, des murs d’indifférence (ou de mépris) sur fond de chômage, de crise du logement et de misère sociale ».
En 2009, la commune de Molenbeek connaît d’autres incidents entre jeunes et police. Les journaux titrent « Bruxelles sur un volcan » (La Libre Belgique) ou « Molenbeek sous haute tension » (Le Soir). Ces incidents se déroulent en période de ramadan, et font suite à l’interpellation d’un jeune par la police. Le commissariat est visé. En juillet 2010, c’est le quartier de la Villeneuve, à Grenoble, qui s’embrase, à la suite de la mort d’un braqueur. Scènes de « guérilla urbaine » selon la presse, et déclaration de Brice Hortefeux, ministre de l’Intérieur : « Nous allons rétablir l’ordre public et l’autorité de l’Etat ». Le 30 juillet, Nicolas Sarkozy fera son fameux « discours de Grenoble ». La réponse du Président est sécuritaire, policière et judiciaire, et pointe du doigt l’immigration : « (…) il faut le reconnaître, je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d’immigration insuffisamment régulée qui ont abouti à un échec de l’intégration ». Un mois après, 128 camps d’immigrés illégaux sont démantelés et on annonce que près de 1000 Roms vont être expulsés. Dans la foulée, Éric Besson introduit, dans le projet de loi sur l’immigration, un amendement étendant la déchéance de nationalité aux « français naturalisés depuis moins de 10 ans condamnés pour meurtre ou tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique ». Projet de loin qui reviendra au devant de la scène politique et médiatique à la suite des attentats de Paris, en novembre 2015.
Dans le quartier, les habitants se mobilisent, créent un collectif et publient un livre blanc, pour lutter contre les amalgames dont ils sont victimes. Cinquante organisations se mobilisent autour d’un appel à manifester, qui réunira plusieurs milliers de personnes. Cet appel s’intitule « Face à la xénophobie et à la politique du pilori : liberté, égalité, fraternité ». Tout comme le Cahier de Doléances de 2005, les associations locales jouent le jeu de la République : « Le nécessaire respect de l’ordre public n’a pas à être utilisé pour créer des distinctions entre les habitants de ce pays et désigner des boucs émissaires (…). La Constitution de la France, République laïque, démocratique et sociale, assure ‘l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion’. (…) Nous appelons à une manifestation le samedi 4 septembre 2010, place de la République à Paris, à 14h00, et partout en France, afin de fêter le 140e anniversaire d’une République que nous voulons plus que jamais, libre, égale et fraternelle. »… Mais là encore, « l’Etat républicain », via ses dirigeants, ne répond pas à l’appel.
En octobre 2010, un rapport au nom charmant de « Rapport d’information fait au nom du comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques sur l’évaluation des aides aux quartiers défavorisés », présenté à l’Assemblée nationale (n°2853), fait le constat d’une crise d’identité et de légitimité de l’Etat, et tire la sonnette d’alarme par rapport aux valeurs de la République : « L’économie parallèle s’est développée, les islamistes radicaux se sont installés, changeant parfois la perception locale de la République, de la laïcité et des droits des femmes » (p. 280).
En Belgique, Molenbeek connaît de nouvelles émeutes en 2012, suite à l’arrestation d’une jeune femme en niqab refusant de montrer ses papiers. La jeune femme est proche de l’organisation « Sharia4Belgium », une organisation djihadiste belge, qui recrute des jeunes pour aller combattre sur le front syrien. En février 2015, son leader, Fouad Belkacem, ex-délinquant, ex-revendeur de voitures, condamné pour vols, cambriolages, trafic de drogue au Maroc, etc., est condamné à 12 ans de prison. En avril 2016, sur les plus ou moins 500 Belges partis combattre en Syrie et en Irak, 79 étaient liés à Sharia4Belgium, soit 15%.
A partir de 2015, lorsqu’on entendra parler de Molenbeek ou de la banlieue parisienne, ce ne sera plus pour des émeutes, mais pour la traque des terroristes du Bataclan ou de Bruxelles.
Durant près de 40 ans, la situation s’est dégradée dans ces quartiers « ghettoïsés » de France et de Belgique. Chaque explosion de violence a eu comme conséquence une réponse plus sécuritaire, plus technocratique, plus judiciaire de la part des pouvoirs publics. Et chacune de ces réponses a eu comme conséquence le renforcement d’un sentiment d’abandon de la part des populations vivant dans ces quartiers.
Si l’on se réfère à la littérature sur la notion d’empowerment, tous les ingrédients ont été réuni pour que les habitants de ces quartiers perçoivent leur impuissance, leur « powerlessness » : incapacité à exercer un contrôle sur la définition et la nature des changements qui les concernent (Rappaport, 1987 ; le Bossé, 2003), faillite du système, institutions qui ne répondent plus (Lord & Hutchinson, 1993), etc.
Loin de défendre la délinquance, les habitants demandaient que des mesures soient prises pour prévenir cette criminalité, dont ils étaient eux-mêmes victimes, directement ou indirectement (par l’image du quartier). Qu’ils jouent le jeu de la démocratie, en portant aux élus des revendications en matière d’emploi, de scolarité, de logement, de culture, etc., rien n’y fit. Et le sentiment s’installa de n’être pas entendu. Toutes ces associations et collectifs émanant des quartiers ont joué le jeu de la « délégation », déléguant aux représentants de l’Etat le soin de prendre en compte les demandes de la population, laborieusement collectées dans des cahiers de doléances et autres livres blancs. Mais l’Etat était déjà ce bateau en train de couler…
Probablement que le sentiment de ne pas être assez Français, ou Belge, pour être entendu s’est également progressivement imposé. Et la situation a pris un caractère de plus en plus identitaire. Et cette identité s’est progressivement affirmée en référence à l’islam.
1.2. D’un islam émancipateur à un islam de survie
Il est évident que l’islam est une religion implantée en banlieue française et dans les quartiers défavorisés de Belgique, puisqu’y vit une large population issue des vagues d’immigration depuis les pays arabo-musulmans.
Dès le début des années 2000, Al-Qaïda a pu bénéficier de soutiens à Bruxelles, et en particulier dans les quartiers dont nous venons de parler. On se rappelle que les assassins de Massoud vivaient dans la capitale belge. En 2001, Nizar Trabelsi, suspecté d’appartenir à Al-Qaïda était arrêté à Uccle (autre commune de Bruxelles) : il projetait un attentat contre l’ambassade des Etats-Unis en France, ainsi qu’un attentat-suicide au camion piégé sur une base aérienne belge. On se rappelle également que la première femme d’origine européenne à avoir perpétré un attentat-suicide en Irak, le 9 novembre 2005, était belge et vivait à Saint-Josse-ten-Noode, une commune de Bruxelles, qui est aussi la commune la plus pauvre de Belgique. A la même époque, Jean-François Abdullah Bastin, un habitant d’Anderlecht, converti, fonde le « Parti Jeunes Musulmans ». Il présentera une liste aux élections régionales bruxelloises de 2004 et aux élections communales de 2006, à Anderlecht et à Molenbeek. Il qualifiera aussi Ben Laden de « Robin des bois moderne » et fera l’apologie du 11 septembre…
Mais cela restait confiné à une minorité d’extrémistes – dont on a certainement sous-estimé le pouvoir d’expansion. Au-delà des filières terroristes, ce qui m’intéresse, c’est de savoir comment les populations de ces quartiers, de manière plus globale, se sont réappropriées la religion, au point d’en faire un élément central de leur identité. Et pour certains, l’élément unique de leur identité. Qu’est-ce qui fait que certains jeunes se sont radicalisés ? Ce qui m’intéresse, c’est de comprendre l’adhésion des jeunes au salafisme.
Pour cela, je crois qu’il est intéressant de faire un petit détour par les Etats-Unis. Le tournant salafiste s’est fait là-bas un peu plus tôt qu’en Europe, et a convaincu beaucoup de convertis. De plus, l’islam des quartiers ghettoïsés s’inscrit dans le mouvement hip-hop qui – je l’ai montré précédemment – constitue une partie de la « bande-son » des mouvements émergents actuellement.
1.2.1. Nation de l’Islam et Black Pride

Historiquement, c’est par la Nation de l’Islam que l’identité islamique s’est implantée dans la population afro-américaine des quartiers les plus défavorisés. Cette forme d’islam, très hétérodoxe, fort éloignée de l’islam du monde arabe, prônait une suprématie de la race noire et constituait un vecteur d’émancipation des populations afro-américaines (Brodard, 2014 :3). Dans ce cadre-là, la référence à l’islam servait l’affirmation d’une posture positive et fière, de la part des populations noires, face à l’oppresseur blanc. Malcolm X est certainement la figure marquante de ce processus d’émancipation, bien qu’il quitta l’organisation en 1964. Les Black Muslims ont utilisé l’islam comme un moyen d’auto-développement, d’aide communautaire et personnelle, et donc comme un mouvement social pour le changement, comme l’affirme l’un des acteurs associatifs de la mosquée Dawah, de Chicago, interviewé par Brodard (2014 :6). Ce mouvement relève d’un processus d’empowerment, au sens où je l’ai défini.
Autrement dit, les Blacks Muslims ont pu puiser dans cet islam hétérodoxe, une base solide pour lutter contre les fléaux sociaux auxquels ils faisaient face : discrimination, chômage, pauvreté, éclatement des cellules familiales, criminalité, drogue, etc.
Et la figure très charismatique de Malcolm X a contribué au nombre important des conversions à l’islam parmi les populations afro-américaines.
1.2.2. Five Percenters et Hip-Hop
En 1964, un étudiant de Malcolm X prend ses distances avec la Nation de l’Islam et fonde une organisation appelée « Five-Percent Nation ». Il s’agit de Clarence 13X Smith » a.k.a « Allah the Father ». Les Five-Percenters, comme se font appeler les adeptes de cette théologie, croient que le monde se compose de 10% d’individus qui connaissent la vérité sur Dieu et sur le monde, et que ceux-ci laissent volontairement 85% de la population mondiale dans l’ignorance. Les 5% restants – les Five Percenters – connaissent la vérité et cherchent à éclairer cette population manipulée. Le peuple noir est perçu comme celui des premiers hommes sur Terre et des héritiers de la nature divine. C’est cela qui leur permet de s’attribuer le titre d’Allah. On est loin de l’islam orthodoxe !
Cette forme d’islam a rencontré un fort succès parmi les afro-américains, dans les quartiers défavorisés, en utilisant la culture hip-hop comme vecteur principal de ses idées (Brodard, 2014 :14). Les Five Percenters ont constitué un pont entre la longue tradition des Black Muslims dans les quartiers ghettoïsés et l’émergence du mouvement hip-hop et de la culture urbaine.

Encore aujourd’hui, beaucoup d’auditeurs de rap n’ont probablement pas conscience à quel point cette théologie est présente dans les textes des groupes américains qu’ils écoutent : Rakim, Big Daddy Kane, Nas, RZA, Wu-Tang Clan, Busta Rhymes, Erykah Badu, etc., se réfèrent, à des degrés divers, à cette croyance. Dès le début du hip-hop, Kool Herc, qui a lui-même étudié les enseignements de la Five-Percent Nation, remarquait une forte présence de ses adeptes lors des « block parties », ces fêtes improvisées dans les quartiers, où les premiers Dj’s mixaient de la musique pour que d’autres dansent dessus, et qui constituent les premiers pas du mouvement hip-hop. Afrika Bambaataa, autre figure des débuts du hip-hop, et fondateur de la Zulu Nation, avait lui aussi suivi les enseignements des Five-Percenters, dont il se serait inspiré pour développer la philosophie propre à son organisation.
Cette présence de l’islam dans la culture urbaine contribuera, comme la figure charismatique de Malcolm X, à susciter un nombre important de conversions à l’islam. D’autant plus que les Five-Percenters rejettent des titres comme ceux de « prêtre » ou « imam » : chacun parle en son propre nom, de sa propre autorité. « ISLAM » devient, dans cette théologie, l’acronyme de « I Self Lord And Master » (Je suis moi-même Seigneur et Maître). La religion n’est plus seulement un vecteur d’émancipation face à l’oppresseur blanc ; l’individu s’émancipe de l’autorité religieuse elle-même, et de sa soumission à Dieu.
1.2.3. Salafisme et « islam véritable »
L’émergence du salafisme dans ces mêmes quartiers qui avaient vu se développer la Nation de l’Islam et puis les Five-Percenters, est la réponse à cette hétérodoxie extrême. Le salafisme se présente comme l’ « islam véritable », et rencontre un succès grandissant dans les quartiers américains, surtout auprès des populations les plus touchées par la précarité et les moins cultivées, en général et au niveau de l’enseignement religieux en particulier. Les villes de Philadelphie, Newark (New Jersey) et Brooklyn sont particulièrement touchées (Brodard, 2014 :11).
Par la toute puissance de l’individu, élevé au rang de Dieu, et sans organisation, la Five-Percent Nation laisse finalement l’individu bien seul, sans rien à quoi se raccrocher. Durkeim aurait parlé de religion présentant un taux très bas d’intégration, bien plus bas que la religion protestante, en référence à sa typologie des formes de suicide. Dans ma métaphore du bateau, il s’agit de ces individus qui essaient de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Et le salafisme constitue très clairement cette bouée à laquelle se raccrocher : un ensemble de règles très strictes (apparence physique, tenue vestimentaire, rapports hommes-femmes, etc.) qui régissent la vie quotidienne des croyants et le sentiment d’appartenance à un « groupe sauvé », celui de l’Islam véritable, au-dessus de la masse des musulmans égarés (Brodard, 2014). Comment mieux l’exprimer que l’a fait Abd al Malik (2004 :125) : « Afin de ne pas me noyer définitivement, je faisais de ma pratique excessive [de la Religion] une bouée de sauvetage ».
Le salafisme s’inscrit dans une idéologie de la rupture. Tout d’abord avec l’Occident, sur un modèle de retournement du stigmate : « Les rejetés rejettent ceux qui les rejettent », dit Morin (2015), à propos de ces jeunes djihadistes qui ne se sentent pas Français. Mais rupture également avec les autres mouvements islamiques, réduits au rang de sectes déviantes. Et rupture avec le mouvement afro-américain qui, avec la Nation de l’islam et les Five Percenters, plaçait l’homme noir au centre son combat émancipateur. Cette rupture relève de la doctrine salafiste de l’alliance et du désaveu, qui exige des musulmans une soumission absolue à l’islam (Kepel, 2015 :171).
Les mosquées salafistes, qui se multiplient dans ces villes paupérisées, racolent pourtant de nombreux anciens membres de la Nation de l’Islam. Le succès du salafisme s’inscrit sur le même sentiment de rejet et de stigmatisation, avec, en plus, la possibilité de s’en remettre complètement à ses règles strictes, à ses prêches, à sa vision du monde. D’après les mots de l’islamologue Rachid Benzine, la salafisation est « le modèle le plus simple à suivre, le kit des solutions qui offre réponse à tout dans des temps troublés » (Kepel, 2015 : 133).
Le développement de l’islam dans les quartiers ghettoïsés, des années 60 aux années 2010, c’est donc l’évolution d’un mouvement qui mettait l’islam au service de l’émancipation de la population afro-américaine, vers l’allégeance de ces populations à un islam qui se présente comme « véritable », auquel l’individu est amené à déléguer pratiquement l’entièreté de son quotidien. D’un processus d’empowerment à une situation d’abandon…
2. Identité et radicalité
« En général quelque puisse être le résultat des questions de religion, on ne peut jamais connaître si l’amour-propre n’a pas été le principal poids déterminant » (Pierre Bayle, « Réponses aux questions d’un provincial », 1704 à 1707)
2.1. Crise identitaire et riposte religieuse
Le gros bateau de la société industrielle forgeait nos identités. Notre identité en tant que membre d’une société spécifique, et notre identité relative à la place, au rôle, que chacun occupait dans cette société. Dans un sens, nous avions « délégué » à d’autres le fait de dire qui nous étions. La crise de la délégation est par conséquent également une crise de l’identité.
« Aujourd’hui, un gamin des quartiers nord [de Marseille], qu’il s’appelle Mohamed, Mamadou ou Ismaël, sa seule certitude identitaire est religieuse. Il sait qu’il est musulman, ce n’est pas négociable », dit Maurad Goual, candidat aux élections législatives françaises en 2012, relayé par Kepel (2015 :98). Autrement dit, « Musulman » devient le trait identitaire principal de ces jeunes. Cela signifie que la seule manière pour eux d’exister, c’est en tant que musulman. Et la seule manière d’être musulman, à leurs yeux, c’est de rejoindre l’ « islam véritable ».
La plupart des jeunes de cette génération sont nés juste après l’échec de la Marche des Beurs (1983) et ont grandi dans ces confrontations aux forces de l’ordre qui ont jalonné les 20 dernières années de leurs quartiers. Là où il n’y a plus rien d’autres – à leurs yeux – l’islam leur permet de réaffirmer une identité fière, une appartenance, et de se retrouver une quête d’absolu.
Le rapport « The Foreign Fighters Phenomenon in the EU – Profiles, Threats & Policies », publié en avril 2016, par l’ « International Centre for Counter-Terrorism » de la Haye, dresse le profil des Européens partis combattre en Syrie et en Irak. Ils ont en moyenne 25 ans. Les jeunes djihadistes belges sont décrits comme des jeunes en colère, « ressentant l’exclusion et l’absence d’appartenance, comme s’ils n’avaient pas de place dans la société », et ceux originaires des Pays-Bas, comme « frustrés par rapport à leur position sociale », ne se percevant pas d’avenir.
Kepel écrivait déjà, en 1991 : « La réislamisation ‘par le bas’ est d’emblée et surtout une façon de reconstruire une identité dans un monde qui a perdu son sens et est devenu amorphe et aliénant ». Et Huntington, qui se réfère d’ailleurs à cet extrait de Kepel, dans son célèbre « Choc des civilisations » (1997), donne un exemple très fort de cette ré-islamisation, avec l’effondrement de la Yougoslavie. « Lorsque l’identité yougoslave s’est effondrée, écrit-il, ces identités religieuses, limitées et banales, ont pris une nouvelle signification et se sont durcies dès que les combats ont commencé » (Huntington, 1997 :403). Cela ne se limite d’ailleurs pas à l’islam, puisqu’il montre que les Serbes de Bosnie sont devenus des nationalistes serbes extrémistes, s’identifiant à l’idée de Grande Serbie et à l’Eglise orthodoxe, et que les Croates de Bosnie sont devenus des nationalistes croates, se sont identifiés aux Croates de Croatie, et ont accentué leur catholicisme. Mais ce rattachement à une civilisation a été plus fort encore, selon Huntington (1997 :404), chez les musulmans. Alors que les musulmans de Bosnie avaient un comportement hautement laïc, tout cela a changé avec l’éclatement de la Yougoslavie : « L’islam a pris une plus grande importance au sein de la communauté nationale musulmane et une identité nationale musulmane forte est devenue une donnée politique et religieuse ».
Je suis convaincu que ce qui s’est joué dans les quartiers en voie de ghettoïsation est relativement similaire à ce qu’il s’est passé avec l’éclatement de la Yougoslavie, si ce n’est que nos Etats ne se sont pas effondrés si vite. Cela a mis plusieurs décennies, jalonnées, dans ces quartiers, d’émeutes et d’appel aux réactions de l’Etat. Et ici aussi, les identités religieuses se sont durcies, dans un contexte d’effondrement du pouvoir.
Huntington écrit avant le 11 septembre, avant les printemps arabes, et avant l’émergence de l’Etat islamique, et à bien des égards, on peut dire qu’il n’a pas vu ces événements venir. Néanmoins, il est indéniable qu’il a vu juste sur l’importance de l’identité dans la résurgence de l’islam. Il avait raison d’écrire : « Pour qui se demande qui il est et d’où il vient, la religion apporte une réponse consolatrice », ou encore « les groupes religieux rencontrent les besoins sociaux laissés sans réponses par les bureaucraties étatiques » (Huntington, 1997 :135, 136). Surtout, il a vu que lorsqu’un Etat perdait de sa légitimité identitaire, les peuples se raccrochaient à leur identité religieuse, nationale, régionale ou ethnique.
Gérard Mauger, dans sa sociologie des quartiers populaires, avait également pointé cette « surenchère dans la ‘pureté’ religieuse » de la part d’une fraction des jeunes musulmans de cités. L’offre religieuse musulmane, dit-il, favorise une « revalorisation symbolique », sur le mode du Black is beautiful : elle valorise une propriété – « arabe » – ordinairement stigmatisée par le racisme ordinaire, et en fait une propriété valorisante. (Mauger, 2006 :194).
Je fais l’hypothèse que, pour beaucoup de ces jeunes radicalisés, l’attrait pour le djihad, que ce soit par un réel départ vers la Syrie, ou uniquement en postant des vidéos, en adoptant une posture ou le langage du djihad, relève de ces pratiques de rue qui permettent, comme l’ont montré Olivier & Boisvert (2000 : 43) de mettre en scène leur propre crise existentielle, symbolique et sociale. Ces jeunes ont décroché. Parfois, mais pas toujours, de l’école. Souvent des institutions, de l’appartenance nationale, de la culture occidentale. Et ce décrochage évoque l’échec, l’incapacité, l’abandon (Olivier & Boisvert, 2000).
Et les recruteurs étaient là pour leur tendre une bouée à laquelle se raccrocher, pour leur apporter « une réponse totale qui comprend à la fois des valeurs très strictes et des règles de comportement pour tous les moments de la vie quotidienne » (Boutih, 2015 :31). Comment expliquer que ces jeunes qui semblent avoir refusé l’autorité toute leur vie (école, parents, police, etc.) en viennent à se soumettre à une telle autorité, prétendant régenter tous les aspects de leur vie ? Ma réponse est, d’une part, que l’autorité scolaire fait partie du bateau qui coule, et d’autre part, que cette voie se présente comme la seule manière d’exister. Daech leur promet un salaire, une maison, une femme, une fonction. Toutes des choses que nos sociétés n’osent plus promettre à ces jeunes. Et puis, de la fierté aussi. De la fierté identitaire. En 2009, Antoine Sfeir et Christian Chesnot – pour rappel, ce dernier a vécu 124 jours détenu en otage, avec Georges Malbrunot, par l’Armée islamique d’Irak – écrivaient déjà : « s’afficher comme radical, c’est réagir, exister, s’imposer à celui qui vous nie. Le djihad, dans ce cadre, est un concept porteur » (Sfeir & Chesnot, 2009 : 118).
En interrogeant des jeunes djihadistes irakiens, Lydia Wilson (2015) remarque que Daech a fourni à ces jeunes « humiliés » par l’invasion américaine et enragés contre le gouvernement chiite qui oppressait les Sunnites, « une manière de défendre leur dignité, leur famille et leur tribu ». Daech était la « promesse de vivre fièrement comme des Arabes sunnites irakiens ». En Europe, le message de Daech est entendu par ces jeunes comme la promesse de vivre fièrement comme Arabe, comme Musulman, ou de vivre simplement avec un avenir, un sens à sa vie. Rejoindre ce djihad pour exister. Mourir en martyr pour vivre une vie meilleure dans l’au-delà. D’autant plus que Daech fait croire à ces ex-petits délinquants qu’ils peuvent racheter leur conduite passée en devenant djihadistes.
Mais la crise existentielle, qui est, à mon sens, une dimension de la crise de la délégation, est bien plus large qu’une crise d’identité des jeunes d’origine musulmane, ou des quartiers populaires. Comme le dit Kepel (2015 :176), le salafisme parvient à hameçonner des « jeunes un peu perdus en quête d’absolu ».

Et des jeunes un peu perdus, en perte de repères, on en trouve partout, et potentiellement dans toutes les catégories sociales et origines ethniques confondues (Khosrokhavar, 2014). Roy (2015 :15) fait d’ailleurs un parallèle entre les jeunes djihadistes et les jeunes tueurs de masse américains qui attaquent leur propre école, comme à Columbine, en 1999.
Les églises peuvent d’ailleurs jouer un rôle identique de « lieux auxquels se rattacher quand on est dans la logique de la rue », pour des jeunes d’Afrique subsaharienne, à Bruxelles, comme le souligne Mazzochetti (2011) : « elles semblent (…) offrir à ces jeunes ce dont ils manquent le plus cruellement : une affiliation, une place, un sens. Elles permettent de s’affirmer fièrement ».
Alors, bien sûr, les églises catholiques n’ont rien produit – aujourd’hui – de similaire au djihad. Mais la référence est importante pour inscrire le rattachement de certains jeunes au salafisme dans le cadre plus large d’une crise de nos sociétés. Je pense que cette crise est générale, même si elle s’est davantage marquée dans les milieux les plus fragilisés, ceux dont nous avons parlé, c’est-à-dire les quartiers en voie de ghettoïsation. Et la « bouée de sauvetage », permettant de retrouver un sens, une identité, une quête, quitte à s’y abandonner complètement, à été, pour les populations d’origine arabo-musulmane de ces quartiers, la voie de l’islam radical.
2.2. Islamisation de la radicalité
« Mais ils croiront que Ben Laden est un héros. En foulard palestinien, sur les roues de leurs motos » Medine. Chanson : « 11 Septembre »
Je crois que la recherche d’identité n’a pas été le seul vecteur de l’attrait pour Daech en Europe. Comme je l’ai montré, les quartiers d’où proviennent la majorité des djihadistes ont connu plus de 30 ans de soulèvements, d’émeutes, d’appels aux politiques. Mais rien n’a changé, sauf peut-être un sentiment grandissant d’impuissance et de relégation, et une volonté de vengeance, une rage, une radicalité, que l’Islam salafiste a pu mettre en forme. En ce sens, je suis assez d’accord avec Olivier Roy, lorsqu’il affirme dans « Le Monde » (24 novembre 2015) qu’il s’agit d’une « islamisation de la radicalité », et non d’une radicalisation de l’islam.
En 2006, juste après les émeutes de Clichy-sous-Bois, Mauger (2006) voyait dans la culture hip-hop et dans le « revival de l’islam » (qui ne sont pas étanches selon lui !), des moyens d’orienter une révolte diffuse et des aspirations confuses.
Parce qu’à y observer de plus près, ce qui est nouveau chez ces jeunes, c’est davantage leur islamisme que leur radicalité qui, elle, a préexisté sous d’autres formes. Je pense, par exemple, qu’on a sous-estimé dans les analyses, le lien de certaines personnes arrêtées pour terrorisme en Belgique, avec les « Kamikazes Riders ». Ce club de motards né en 2003, à Anderlecht (cette commune de Bruxelles, limitrophe à Molenbeek, dont j’ai parlé à propos des émeutes), est d’abord connu pour ses acrobaties sur le périphérique de Bruxelles (qu’on appelle « le ring »), et leurs apparitions dans plusieurs clips de rap. Mais en 2012 et 2013, certains de leurs membres sont condamnés pour terrorisme dans le cadre du dossier Sharia4Belgium. Fin 2015, deux membres du club sont arrêtés parce que soupçonnés d’avoir planifié un attentat pour le nouvel an, à Bruxelles.

Bien sûr, tous les membres de ce club de motards ne sont pas des djihadistes. Mais les Kamikazes Riders et les kamikazes tout court, les terroristes de Paris et de Bruxelles, partagent les mêmes conditions de vie, dans les mêmes quartiers. Et dans les récits des jeunes arrêtés ou revenus de Syrie, on retrouve incontestablement la même recherche de sentiment d’existence, que lorsqu’on interroge les adeptes de pratiques à risque.
Les vidéos des Kamikazes Riders cartonnent sur Youtube, et circulent parmi les jeunes – j’en ai été témoin lorsque j’enseignais à Anderlecht. Tous mes élèves connaissaient le club. Je crois qu’ils trouvaient dans ces vidéos, une mise en scène du risque, comme moyen de se sentir exister, et une mise en avant d’une certaine maitrise des choses, que ce soit de sa moto, de son corps, etc. « L’important, c’est pas la vitesse, mais la maîtrise », peut-on lire dans des vidéos des Kamikazes Riders.
Sur Youtube, on trouve pléthore de vidéos similaires : le célèbre Ghost Rider en wheeling, à 353 km/h sur l’autoroute, les vidéos « People Are Awesome », ou les vidéos de jeunes jouant les équilibristes en haut des grues et des buildings, en particulier en Russie… Toutes ces vidéos ont généralement plus de 8 millions de vues !
Comme l’a très bien expliqué Mauger (2006), les transformations dans le monde ouvrier (disparition de branches entières de l’industrie, nouvelles technologies, etc.) ont fini par disqualifier la force de travail physique, liée aux emplois ouvriers. Par là, des valeurs qui occupaient une place centrale dans la culture de l’atelier (courage, endurance, dureté) et qui participaient à la définition de l’identité masculine dans les milieux populaires, n’ont plus trouvé d’autres lieux d’expression que dans la rue et ses pratiques à risque.
Le travail ouvrier impliquait des dangers, sur échafaudages ou grues, à proximité des hauts fourneaux, dans les mines, etc., et permettait l’expression d’une maîtrise technique. Mais que ce passe-t-il lorsque ces métiers n’existent plus, ou se dévalorisent ? Les valeurs et les normes persistent aux changements du monde du travail, et trouvent d’autres lieux d’expression, dans la rue ou sur les sentiers du djihad. Le « capital guerrier » dont parlait Sauvadet (2006), comme ensemble de ressources accumulées par les jeunes de cité pour s’imposer (force physique, code d’honneur, discipline morale, etc.) a pu, chez certains – une minorité, mais non-négligeable – prendre un caractère réellement guerrier.
A côté de cela, l’islamisme a pu aussi fonctionner comme moyen d’exprimer une radicalité, jusqu’à être à la limite de la parodie. Comment se poser comme révolté ? Pourquoi pas en reprenant toute l’imagerie et le langage du djihad ? C’est ce qu’ont fait certains rappeurs, assez proches des Kamikazes Riders, comme le rappeur belge « Ben Label », en référence à Ben Laden. Son 1er album sort d’ailleurs le 11 septembre 2011 et est présenté comme du « rap de terroriste ». Ben Label est un pote de rappeurs français comme Morsay ou Zehef. Le terrorisme islamiste comme prêt-à-l’emploi de la radicalité. Ces jeunes mélangent tout : le conflit israélo-palestinien, les problèmes d’intégration, un complot mondial, les inégalités sociales, etc. La fascination pour le djihad est, pour eux, une revanche contre un Occident, une Europe, dont ils se sentent relégués. Le rappeur Medine écrira, dans son morceau « Ni violeur ni terroriste » : « C’est juste par manque de culture qu’Oussama Ben Laden est écrit sur les murs ».

Aux Etats-Unis, nous l’avons vu, hip-hop et Islam étaient également liés, avec les Five-Percenters, mais la religion était au service d’une forme d’empowerment, de reprise en main des choses par les populations afro-américaines, des ghettos. En Europe, l’Islam des quartiers vient davantage nourrir la radicalité de ces jeunes élevés au Hip-Hop.
Dans son rapport « Génération radicale », Malek Boutih (2015 :29-30) écrivait que le profil des djihadistes avait évolué à partir des années 90 : des jeunes de cités « qui pensent que la société leur en veut, les déteste, qu’ils sont les victimes innocentes de gens qui les marginalisent en les enfermant dans ces espèces de ghettos que sont les cités ».
Quête de sens, questionnement identitaire, sentiment d’exclusion, c’est ce qui revient toujours dans les analyses des jeunes radicalisés. Et petite délinquance : la moitié des jeunes djihadistes partis de Belgique étaient connus pour des faits de petite délinquance. En Allemagne, deux tiers étaient connus des service ce police. Certains sont passés par la prison, comme Amedy Coulibaly, l’un des auteurs des attentats de janvier 2015 à Paris, ou les frères El Bakraoui, deux des auteurs des attentats de Bruxelles, qui avaient été condamnés pour braquage et car-jacking dans le passé. Comme l’explique le politologue Asiem El Difraoui dans l’Express (02 octobre 2014), « Daech récupère plutôt les rejetons des sociétés occidentales, tels Mohamed Merah ou Mehdi Nemmouche : des jeunes en marge, des petits voyous, des gens largués cherchant un sens à leur vie ». Morin (2015 :9) rajoute : « L’idée du djihad, du martyre, s’empare d’esprits juvéniles, parfois après bien des errances et des échecs », et cite Khaled Kelkal et Mohamed Merah comme « de jeunes Beurs nés en France », qui ont « oscillé entre intégration, délinquance et djihadisme ».
Comprenons-nous bien, il ne s’agit nullement de plaindre les terroristes, encore moins de les excuser. Le détour par un historique des « problèmes » en banlieue et par une sociologie des jeunes des milieux populaires, vise à comprendre l’effondrement progressif de la société industrielle, le vie que cela a laissé, l’abandon réel ou ressenti par certains et la manière dont ils ont pu se raccrocher à un combat, fourni « clé en main », qui a abouti à la mort de centaines de personnes, ces dernières années, en Europe…
2.3. Nihilisme et No Future : conclusions sur le djihad
« Alors tout est combattu de façon absolue, rien ne peut être sauvé ni même discuté, il faut simplement que la rage se développe et s’exprime, joue à détruire un monde qui semble alors détesté, qui serait le ‘mal’ s’il existait une image du ‘bien’ ».
Cette phrase décrirait probablement très bien cette espèce de haine incompréhensible que les jeunes terroristes, élevés en France ou en Belgique, éprouvent pour notre monde, et leur volonté de tout détruire… Mais elle est écrite par le sociologue François Dubet, en 1987, dans son célèbre ouvrage « La galère : Jeunes en survie », à l’issue de sa recherche sur les jeunes de certaines cités, comme Les Minguettes, Clichy, ou Seraing en Belgique.
Durant des décennies, les sociologues ont étudié ces quartiers en voie de ghettoïsation, mais les gouvernements n’ont réagi que lorsque, épisodiquement, la violence était au devant de la scène médiatique : émeutes, échauffourées avec la police, etc. Et la réponse n’était que technique, sécuritaire, policière.
Plusieurs principes organisant la « galère » dont parlait Dubet en 1987 se retrouvent dans le discours des jeunes attirés par le djihad aujourd’hui. En premier lieu, le sentiment d’impuissance, de « powerlessness » (Dubet, 1987 :74) dont nous avons dit, dans le chapitre introductif à la notion d’empowerment, qu’il était le point de départ de réactions de l’individu ou des groupes pour reprendre un pouvoir sur les choses.
La « rage », autre principe de la galère, que Dubet (1987 :91) décrit comme l’« expression de la violence pure » et comme une forme de « nihilisme », un « désir de détruire désespéré face à un avenir vide » (Dubet, 1987 :91), ne s’est pas calmée depuis les années 80. Elle a pris entre autres la forme du djihad. Elle s’est reconnue dans la volonté de l’Etat islamique de tout détruire pour reconstruire quelque chose d’autre. Ceux que la République a répudiés comme « racailles » sont revenus comme djihadistes. On n’a pas entendu les « émeutiers », on doit faire face à des combattants prêts à mourir.
On entend parfois quelques analystes dire qu’il faut s’attaquer à Daech « à sa source », à savoir, pour eux, la Syrie ou l’Irak. Mais les attentats en France et en Belgique sont l’œuvre de jeunes belges et français. La question est : comment est-ce possible que des jeunes élevés ici aient développé une telle haine envers notre société ?
Plus encore, la question est : est-ce que cette haine n’aurait pas pu prendre un autre caractère que l’islam ? Si tel est le cas, ça renforce l’idée de Roy selon laquelle on assiste davantage à une islamisation de la radicalité, plutôt qu’à une radicalisation de l’islam. Une islamisation de la « rage » de Dubet, en somme. Je pense qu’on est plus proche de la réalité sociologique en disant que certains « enragés » se sont islamisés, plutôt qu’en disant que l’islam s’est « enragée », ce qui ne correspond pas à la réalité des millions de musulmans en Occident. Le problème est qu’à cette haine islamisée, va répondre une haine de l’islam. On commence très clairement à le voir.
Le bateau de notre société industrielle coule tout doucement depuis pas mal d’années, et l’une des prémisses de ce naufrage a probablement été, dès la fin des années 70, l’incapacité de la société à fournir un avenir à sa jeunesse. En 1979, Pialoux parlait déjà, en France, de « jeunes sans avenir ».
De cette époque à aujourd’hui, la jeunesse sans avenir a pu expérimenter son « no future » sous de nombreuses formes : conduites para-suicidaires, comportements à risque (drogues, mise en danger de soi), auto-destruction (de soi ou de son lieu de vie, lorsqu’on brûle son propre quartier), décrochage, abandon, vie dans la rue, rejet, galère, etc.
Sans avenir, se raccrocher à ses origines peut avoir du sens. S’y raccrocher comme à la seule manière de garder la tête hors de l’eau. Edgar Morin (2015 :8) résume très bien l’enjeu, en faisant dire à ces jeunes : « On ne peut être un vrai Français, mais on peut devenir un vrai Musulman ». D’autant plus qu’une part des intellectuels a précisément renvoyé ces jeunes à leurs origines. On se rappelle des propos de Finkielkraut dans le journal Haaretz (18 novembre 2005) : « En France, on voudrait bien réduire les émeutes à leur niveau social. Voir en elles une révolte de jeunes de banlieues contre leur situation (…). Le problème est que la plupart de ces jeunes sont noirs ou arabes et s’identifient à l’Islam. »
Il était faux de dire que les émeutiers mettaient le feu en tant qu’arabes ou musulmans. Ils mettaient le feu en tant qu’ « individus ne se sentant plus Français (ou Belges) ». Mais une part de l’opinion publique les a renvoyé à leurs origines ethnico-religieuses, auxquelles ils n’ont plus eu qu’à se raccrocher. Ces jeunes gueulaient qu’ils se sentaient abandonnés par la France, ou plus généralement par nos sociétés occidentales démocratiques, ils gueulaient leur impression de ne plus exister, de ne plus avoir d’identité, et on leur a répondu : « Si, si ! Vous avez une identité : pour nous vous êtes des Arabes, des Musulmans, etc. ». On a ethnicisé le problème des banlieues, à partir des années 90, nous l’avons vu. Et devinez quoi ? La dimension ethnico-religieuse est devenue de plus en plus présente…
Petit à petit, le débat est devenu identitaire. On discute de moins en moins de chômage, d’intégration des jeunes, de relance des entreprises, le débat n’est plus qu’identitaire : Qu’est-ce qu’être Français ? Qu’es-ce qu’être laïque ? Qu’est-ce qu’être Européen ? On a progressivement basculé des enjeux de société aux enjeux identitaires. Avant, on parlait du bateau. Maintenant, on parle des individus lâchés en pleine mer. Tout est identitaire : « Je suis Charlie » ou je ne le suis pas, mais le débat portera sur ce que je suis, sur ce que tu es…
Concluons enfin sur deux précautions, comme nous avons commencé ce chapitre. Premièrement, les caractéristiques sociales de banlieue et autres quartiers en voie de ghettoïsation ne créent pas nécessairement le terrorisme, mais ces caractéristiques ont créé un ressenti, une révolte, auxquels les pouvoirs publics n’ont jamais répondu convenablement (en répondant mal ou en ne répondant pas du tout) et ce sentiment d’impuissance, d’abandon, peut amener à se raccrocher aux discours extrémistes comme ceux de Daech. Deuxièmement, il n’y a rien de mécanique dans le fait que la jeunesse immigrée, de descendance arabo-musulmane se tourne vers l’intégrisme et le radicalisme, sauf s’il y a une vraie stratégie consistant à les cibler, comme ça semble être le cas avec cette forme de djihad propre à Daech. Il n’y a donc pas de déterminisme. C’est davantage une logique contre laquelle nous pouvons lutter. Mais cela oblige aussi à faire son auto-examen, en tant que société : ou est-ce qu’on a merdé pour que des jeunes élevés ici, se raccrochent à un discours de haine envers notre société, au point d’aller se faire exploser en plein métro, ou de faire un carnage sur des terrasses de café ? Quelle est notre responsabilité, dans le fait d’avoir délégué à des dirigeants le plein pouvoir de fournir un avenir à nos jeunes ? Et qu’en ont-ils fait ? Comment reprendre ce pouvoir ? Comment nous redonner un avenir en tant que société, en redonnant à notre jeunesse une capacité à se projeter et à s’identifier ?
3. En miroir, la montée de l’extrême-droite
La réaction face à la montée du Salafisme existe. D’autres se mobilisent… Cinq jour après les attentats de Bruxelles, 400 personnes, se définissant eux-mêmes comme « hooligans » débarquent Place de la Bourse, dans le centre de la capitale belge, avec une banderole « FCK ISIS – Casuals Against Terrorism » (Casuals, du nom de ce type de supporters « ultra » de certains clubs de foot). Deux mois avant, en janvier 2016, 200 hooligans masqués avaient agressé des jeunes « typés » immigrés dans le centre de Stockholm, en distribuant des tracts « Maintenant, c’est assez ! », en rapport avec l’immigration. Cette « ratonnade » à l’ancienne fut revendiquée par le « Mouvement de résistance nordique », aussi connu sous le nom de « NordFront », fondé en Suède, en 1997, par d’anciens membres de la White Aryan Resistance, des suprémacistes blancs, vénérant Hitler et le IIIème Reich… Tranquillement.
Le phénomène est né en Allemagne, en 2014 : des organisations de supporters « ultra » qui se définissent comme « hooligans » et qui se rassemblent contre le salafisme. Le réseau s’appelle HOGESA : « Hooligans Gegen Salafisten » (Hooligans contre les Salafistes) et rassemble des associations néo-nazis, nationalistes et de hooligans.
3.1. Hooliganisme contre salafisme
Comme nous le disions en début de chapitre, on ne se réveille pas un matin avec des organisations islamophobes qui manifestent en rue. Cela invite à dresser un bref historique de l’évolution de ces dernières années.
La violence liée au sport existe depuis très longtemps, et c’est dans le football que cette violence s’est le plus marquée, voire quasi-institutionnalisée. Plusieurs chercheurs font remonter le « hooliganisme » à la fin des années 50. Les bagarres ne sont plus liées au match (faits de jeu, arbitrage, etc.), mais « préméditées » : les supporters violents s’affranchissent du sport en soi. Dans les années 60, le public des stades se transforme, il se diversifie, devient plus jeune. Plus jeune aussi. Le football commence à intégrer les pratiques culturelles juvéniles qui émergent à l’époque (Bodin, et al., 2005 :70).
De nombreux chercheurs – et on pourrait citer le célèbre Norbert Elias (1986) – voient dans la crise socio-économique des années 70 à 80, l’émergence de l’hooliganisme que nous connaissons aujourd’hui. A l’époque, la Grande-Bretagne a 14% de sa population au-dessous du seuil de pauvreté, connaît l’inflation, le chômage, les pertes d’emplois dans le secteur industriel (3 millions de 1966 à 1986 !), et subit la réponse ultra-libérale du Tatchérisme. C’est la période du « No Future » du mouvement Punk, et le développement du hooliganisme (Bodin, et al. 2005 :72).
En France, c’est également dans les années 70 que les supporters les plus assidus se constituent en « kops ». Plus tard, dans les années 80, ces supporters prendront modèle sur les « ultras » italiens, et sur les « hooligans » britanniques (Hourcade, 2000 :108).
Dès la moitié des années 80, et plus encore dans les années 90, on commence à relever des signes d’extrême-droite au sein de ces groupes : croix celtiques, slogans racistes, etc. Certains groupes de supporters se rapprochent ouvertement des organisations d’extrême-droite. C’est aussi la période des skinheads fascistes, dont certains font partie du milieu des supporters ultras. En 1989, une figure française du mouvement skinhead, Serge Ayoub, surnommé « Batskin », crée le Pitbull Kop, qui sera la branche « supporter » de son organisation politique, les Jeunesses nationalistes révolutionnaires (Hourcade, 2000 :115). Cette organisation, active dans les années 80 et 90, sera réactivée dans les années 2010, avant d’être à nouveau dissoute.
Le fait est que, durant les années 80, des groupuscules néo-nazis tentent d’infiltrer des groupes d’hooligans. Le but est de recruter. Pour l’extrême-droite, ceux-ci sont en quelque sorte des « professionnels de la bagarre » et de la confrontation avec les forces de l’ordre. Le 4 juillet 1989, plusieurs dizaines de jeunes, appartenant au « kop » du RWDM, le club de foot de Molenbeek, et se surnommant les « Brussels Boys », organisent une petite expédition punitive contre des jeunes d’origine immigrée, dans Bruxelles. Comme pour les émeutes à Saint-Guidon, mais près de 20 ans plus tôt, tout était parti d’une rumeur : des « Marocains » auraient attaqué des supporters quelques jours plus tôt ; ils voulaient se venger. A l’époque, les supporters les plus violents et les plus nationalistes de Bruxelles sont ceux de Molenbeek et d’Anderlecht.
L’enquête de Hourcade, réalisée entre 1993 et 1999, relève déjà des propos racistes dans les tribunes du PSG : « La France aux Français », « Immigrés dehors, terroristes à mort ». Durant les années 90, les hooligans tentent de se dissocier, dans et hors des stades, des « racailles ». L’enjeu est en partie territorial : si les « racailles » – indistinctement associées aux immigrés – font la loi dans les cités, les hooligans font, eux, la loi aux abords des stades.
Au sein des Hooligans, une tendance se crée progressivement : les « Casuals ». Ils ne portent plus de vêtements à l’effigie de leur club, comme les autres supporters, mais des vêtements de sport « normaux », de « tous les jours » (ce que signifie « casual » en anglais). Le but est en partie de passer inaperçu, vis-à-vis des services d’ordre aux abords des stades. Plus généralement, ces supporters s’autonomisent fortement de l’aspect football. Ce n’est plus la défense du club, et la confrontation aves les supporters adverses, qui sont recherchées, mais une recherche d’exaltation dans la violence. Bernardeau Moreau et al. (2008), dans une enquête de terrain au sein de supporters du PSG, relatent ces propos d’un jeune Casual :
« Ce qu’on aime c’est sentir l’adrénaline monter, cette sorte de pression avant d’aller se battre. Et le foot ce n’est qu’un prétexte pour se foutre sur la gueule, loin des stades et loin de la police (…) C’est ça une bagarre de hooligans, un combat de rue intense qui procure de multiples sensations fortes et qui permet à chacun de se surpasser pour les autres et pour eux-mêmes. Et souvent alors qu’on goutte à ce genre d’émotions, il est difficile de s’en détacher, on devient dépendant. On veut toujours se battre de plus en plus, prendre de plus en plus de risque et à la fin il est très difficile de se retirer, de se ranger », Julien (Bernardeau Moreau et al. 2008).
Les Casuals représentent également une France blanche patriotique, distincte des milieux populaires immigrés. C’est sous la bannière de « Casuals against Terrorism » que les hooligans se sont rassemblés place de la Bourse, à Bruxelles, 5 jours après les attentats. Les observateurs ont relevé qu’environ 150 hooligans d’Anderlecht en faisaient partie.
3.2. Des ligues de défense nationale à PEGIDA
Je ne retracerai pas toute l’histoire des mouvements d’extrême-droite. Partons de la fin des années 2000, avec la création, en 2009, de l’English Defence League, dont le meneur, Stephen Yaxley-Lennon, a pris le pseudonyme de Tommy Robinson, en référence, semble-t-il, à une figure du hooliganisme de Luton Town, dans les années 80.
Ne s’affirmant ni d’extrême-droite, ni raciste, l’English Defence League prétend lutter contre l’islamisation de l’Angleterre. L’organisation n’est effectivement pas contre tous les étrangers, ni même tous les musulmans, mais elle est clairement nationaliste et anti-salafiste. Cela dit, on sait qu’il y a, au sein de l’extrême-droite, une longue tradition d’utilisation de la lutte anti-terroriste, pour lutter contre ses ennemis traditionnels. Durant longtemps, ce fut le « rouge », le communiste et la gauche révolutionnaire. Aujourd’hui, c’est le musulman (Abramowicz, 2008).
Quoi qu’il en soit, l’English Defence League a créé des émules un peu partout, et entre 2010 et 2012, on a vu apparaître l’European Defence League, la Dutch Defence League, la Polish Defence League, l’Italian Defence League, la Scottish Defence League, la Norwegian Defence League, etc. Cette dernière league aurait compté, parmi ses membres, Anders Behring Breivik, l’auteur de attentats d’extrême-droite, en juillet 2011.
La version belge, « Belgium Defence League » est créée, en 2010, par des supporters ultras, en réponse aux déclarations de Sharia4Belgium. La première réunion est organisée, en mai, à Anderlecht. Le fondateur est un certain « Thure », activiste d’extrême-droite, connu depuis les années 80. Membre de l’ « Assaut », un groupe de néo-nazis nostalgiques entre autres de Degrelle, il assurera à certaines occasions la sécurité de Faurisson, le révisionniste, de passage en Belgique. Il sera également membre du groupe de musique Skin, « Fight Action » ». Cette « Belgium Defence League », qui avait pour but, comme les autres leagues, de défendre la Belgique comme les islamistes, disparaîtra rapidement, mais réapparaîtra en 2013, sous le nom de « Belgian Defence League » (plus « Belgium », mais « Belgian »).
En octobre 2014, en Allemagne, est créé PEGIDA, acronyme de « Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes » (Européens patriotes contre l’islamisation de l’Occident), avec comme point de départ, des manifestations hebdomadaires à Dresde, contre l’islamisation de l’Europe et de l’Allemagne. Très vite, le message prend bien. Des branches apparaissent partout en Allemagne et des organisations similaires sont créées dans de nombreux pays.
Le moins qu’on puisse dire est qu’on retrouve toujours les mêmes. Tommy Robinson, le fondateur de l’English Defence League est coordinateur de PEGIDA UK. En France, son président est un Normand de 25 ans, Loïc Perdriel, chroniqueur sur le site de « Riposte laïque ». Il écrira entre autres que « les migrants sont l’avant-garde d’une armée d’occupation », ou aura des slogans comme « La France aux Français. Migrants dehors ». Renaud Camus, un écrivain français, annoncera publiquement le lancement de la section française de PEGIDA. Il est le père de la thèse du « grand remplacement », selon laquelle nous ferions face à une entreprise délibérée de remplacement du peuple européen (en particulier en France), par des populations originaires du Maghreb et d’Afrique noire. La perte de notre identité, la menace qui pèse sur notre civilisation, sont au centre de son discours. En septembre 2015, il faisait une allocution relayée sur de nombreux sites d’extrême-droite, à la manifestation contre l’immigration, à Paris.
En Allemagne, l’extrême-droite identitaire du mouvement PEGIDA et les hooligans se sont rassemblés dans l’organisation HOGESA : Hooligans Gegen Salafisten. En octobre 2014, ils réuniront 3000 supporters à Cologne.
Depuis les années 80, tout comme on a laissé se développer une réponse salafiste à la crise d’identité et à la recherche de radicalité d’une partie de la jeunesse d’origine immigrée, on a laissé se développer des groupuscules identitaires auprès d’une jeunesse plus autochtone, tout autant en recherche d’identité, et de radicalité.
3.3. La défense d’une identité
Le jeu de miroir avec l’attrait de certains jeunes pour le djihad est saisissant. Les études sur le profil des hooligans convergent généralement vers une tranche d’âge entre 16 et 30 ans. C’est également une population issue majoritairement des classes sociales défavorisées (Bodin et al., 2005 :75). Elias et Dunning (1986) avaient noté que la plupart des hooligans provenaient des milieux les plus défavorisés de la classe ouvrière. Même si des employés et des jeunes scolarisés font aussi partie des groupes de hooligans (Bernardeau Moreau et al., 2008).
Plus intéressant encore, une étude sur les hooligans belges (Van Limbergen, 1992) met l’accent sur leur « vulnérabilité sociétale » : décrochage scolaire (40% ont connu une scolarité courte et s’ils sont en âge scolaire, seulement 16% vont régulièrement au cours), situation sociale précaire, et petite délinquance. 75% des hooligans sont répertoriés par la police, pour des faits de petite délinquance (Bodin et al., 2005). C’est donc même davantage que parmi les jeunes partis combattre en Syrie ou en Irak !
Certains auteurs intègrent l’émergence d’un supporterisme violent dans la désagrégation du monde ouvrier, comme nous l’avons vu, à propos du « revival de l’islam », avec Mauger (2006). L’étude de Bernardeau Moreau et al. (2008) synthétise plusieurs recherches antérieures : les violences autour du football exacerbent un modèle de virilité (Mignon, 1998) et les hooligans concrétisent ce mélange de « résistance physique, de force et de dureté » propres aux milieux ouvriers (Ehrenberg, 1985 :12). Ce même auteur, Ehrenberg (1991), résumera la logique par cette phrase : « Plus nous sommes craints, plus nous existons ».
Le hooliganisme participe d’un mécanisme de survie, là où l’appartenance à la classe sociale ne permet plus aucune reconnaissance sociale (Bodin et al., 2005). C’est survivre, en tant que… Français de souche, en tant que Belge, qu’Anglais, qu’Allemand, que « blanc », qu’européen. Le football est instrumentalisé, écriront Bodin et al. (2005 :73), le hooliganisme « devient l’expression de l’errance socio-économique des jeunes exclus de la société ». Des jeunes « sans repères et sans avenir », dont la révolte va se cristalliser contre l’étranger, qui semble menacer l’identité nationale (Hourcade, 2000 :121).
3.4. Toujours la même recherche de radicalité…
L’extrême droite a su tirer profit de cette révolte diffuse, de ce besoin d’exister, de cette radicalité. Parce que, comme nous l’avons montré, la radicalité préexistait, là-aussi, à l’engagement dans des groupes de défenses identitaires : recherche de sensations fortes dans les bagarres, confrontations préméditées avec d’autres supporters ou avec la police, attrait pour le danger, engagement dans des gangs de motards (particulièrement actifs dans les regroupements comme PEGIDA), etc. Là encore, le parallèle avec les jeunes attirés par Daech est saisissant. Et la logique du « paraître radical » s’exprime dans toutes ces vidéos sur Youtube, et ces blogs de hooligans.
Il y a d’ailleurs des groupes de hooligans d’extrême-gauche, Hourcade (2000 :111) le montre très bien. Mais dans un cas comme dans l’autre, c’est l’extrémisme qui est au fondement de leur rattachement à une idéologie : « seule la revendication d’une tendance politique radicale est compatible avec leur état d’esprit ».
Une aubaine pour l’extrême-droite : des jeunes (plutôt blancs), se sentant exclus de leur société, en recherche de radicalité, d’absolu, d’existence. A l’islamisation d’une forme de radicalité répond une droitisation extrême de cette même radicalité. Et pour comprendre le phénomène, pour comprendre qu’une société se réveille un matin, au 21ème siècle, avec des jeunes partis faire le djihad en Syrie et d’autres qui s’engagent dans des groupuscules d’extrême-droite, il faut, à mon sens, surtout comprendre les causes sociales de cette radicalité. Le fondamentalisme religieux et l’extrême-droite n’ont rien de nouveau, qu’est-ce qui fait qu’à partir des années 80-90, lentement et progressivement, ils commencent à attirer des jeunes élevés dans nos sociétés, pour arriver à la situation que l’on connaît aujourd’hui ?
Je crois que la généalogie de cette radicalité et de la crise identitaire qui y est liée, s’inscrivent dans cette crise de la délégation : crise des institutions auxquelles on a l’impression qu’on ne peut plus déléguer le soin de nous faire appartenir à une société, crise des délégués censés embrasser les demandes d’une population qui leur a délégué le pouvoir d’agir en leur nom, et besoin de se raccrocher à quelque chose, comme seul moyen de survivre, quitte à s’abandonner complètement à cette bouée de sauvetage.
L’offre de radicalité politique et religieuse existait. Il suffisait d’attendre que la demande soit là. Et les groupuscules djihadistes ont pu infiltrer les quartiers, alors que parallèlement les groupuscules néo-nazis infiltraient les groupes de supporters violents. Les discours des prêcheurs salafistes et des « penseurs » d’extrême-droite n’attendaient que des auditeurs à la recherche de ce genre d’absolu dans la défense d’une identité et l’engagement violent.
… Et des vieux imams de l’autre bout du monde ont pu commencer à parler dans les écouteurs des jeunes européens. Et des vieux auteurs comme Marc-Edouard Nabe ou Renaud Camus ont pu, en France, retrouver une certaine popularité auprès de la jeunesse. Le premier, entouré de jeunes dans ses vidéos sur Youtube, s’amusant des attentats de Paris ; le deuxième, applaudit par la foule, lors de discours à l’occasion de manifestations identitaires, refourguant sa théorie du « grand remplacement ».
On en est arrivé là.
BIBLIOGRAPHIE
- Abramowicz, M. 2008. « Terrorisme identitaire : toujours à l’ordre du jour », ResistanceS.be.
- Bernardeau Moreau, D., Bonomi, J., & Collinet, C. 2008. « Le Casual, un nouveau genre de hooligan dans la ville », Les Annales de la Recherche Urbaine, Plan Urbanisme – Construction – Architecture, PP.37-45.
- Bodin, D., Robène, L, & Héas S. 2005. « Le hooliganisme entre genèse et modernité », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n°85, 1, pp. 61-83.
- Boutih, M. 2015. Génération radicale, Rapport auprès du Ministre de l’Intérieur.
- Brodard, B. 2014. « De la ‘Nation de l’Islam’ au wahhabisme : identité culturelle et religiosité chez les musulmans afro-américains », Cahiers de l’Institut Religioscope, n°11, mars.
- Collovald, A. 2000. « Violence et délinquance dans la presse. Politisation d’un malaise social et technicisation de son traitement », in Bailleau, F., & Gorgeon, C. (Eds) Prévention et sécurité : Vers un nouvel ordre social ? Paris : Editions de la DIV, pp. 39-53.
- Dassetto, F. 2012. « Islam belge au-delà de sa quête d’une instance morale et représentative », Cismoc Papers on line, mars.
- Debray, R. 2015. « C’est le moment d’assumer notre ADN culturel », in Fottorino, E. (dir.) Qui est Daech ? Comprendre le nouveau terrorisme, Paris : Le 1.
- Dubet, F. 1987. La galère : Jeunes en survie, Paris : Fayard.
- Elias, N., & Dunning, E. 1986. Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Paris : Fayard.
- Ehrenberg, A. 1985. « Les hooligans ou la passion d’être égal », Esprit, 8-9, pp. 7-13.
- Ehrenberg, A. 1991. Le culte de la performance, Paris : Calmann-Lévy.
- Hourcade, N. 2000. « L’engagement politique des supporters ‘ultras’ français. Retour sur des idées reçues », Politix, vol. 13, n°50, pp. 107-125.
- Huntington, S.P. 1997. Le choc des civilisations, Paris : Odile Jacob.
- International Centre for Counter-Terorism, 2016. « The Foreign Fighters Phenomenon in the EU – Profiles, Threats & Policies », ICCT Research Paper, Prepared for the Netherlands National Coordinator for Security and Counterterrorism, DOI: 10.19165/2016.1.02.
- Kepel, G. 1991. La revanche de Dieu. Chrétiens, juifs et musulmans à la reconquête du monde, Paris : Seuil.
- Kepel, G. 2015. Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français, Paris : Gallimard.
- Khosrokhavar, F. 2014. Radicalisation, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme.
- Kokoreff, M. 2008. Sociologies des émeutes, Paris : Payot & Rivages.
- Le Bossé, Y. 2012. Sortir de l’impuissance, Québec : Editions Ardis.
- Lord, J., & Hutchison, P. 1993. « The Processus of Empowerment : Implications for Theory and Practice », Canadian Journal of Community Mental Health, 12, 1 : 5-22.
- Malik, A. 2004. Qu’Allah bénisse la France ! Paris : Albin Michel.
- Mauger, G. 2006. Les bandes, le milieu et la bohème populaire, Étude de sociologie de la déviance des jeunes des classes populaires (1975-2005), Paris : Belin.
- Mazzochetti, J. 2011. « Dénis de reconnaissance, luttes et affirmation de soi. Enquête auprès de jeunes d’origine subsaharienne à Bruxelles », Uzance, n°1 :90-106.
- Mazzocchetti, J. 2012. « Sentiments d’injustice et théorie du complot. Représentations d’adolescents migrants issus des migrations africaines (Maroc et Afrique subsaharienne dans des quartiers précaires de Bruxelles », Brussels Studies, n°63, novembre, pp. 1-9.
- Mignon, P. 1998. La passion du football, Paris : Odile Jacob.
- Morin, E. 2015. « Essayons de comprendre », in Fottorino, E. (dir.) Qui est Daech ? Comprendre le nouveau terrorisme, Paris : Le 1, pp. 7-11.
- Olivier, L, & Boisvert, Y. 2000. A chacun sa quête. Essais sur les nouveaux visages de la transcendance, Sainte Foy : Presses universitaires du Québec.
- Pialoux, M. 1979. « Jeunes sans avenir et travail intérimaire », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 26, n°1, pp. 19-47.
- Rappaport, J. 1987. « Terms of Empowerment / Exemplars of Prevention : Toward a Theory for Community Psychology », American Journal of Community Psychology, vol. 15, n°2 : 121-145.
- Roy, O. 2015. « Un islam sans racines ni culture », in Fottorino, E. (dir.) Qui est Daech ? Comprendre le nouveau terrorisme, Paris : Le 1, pp. 14-16.
- Sauvadet, Th. 2006. Le capital guerrier. Concurrence et solidarité entre jeunes de cité, Paris : Armand Colin.
- Sfeir, A., & Chesnot, C. 2009. Orient, Occident, le choc ? Les impasses meurtrières, Paris : Calmann-Lévy.
- Van Limbergen, K. 1992. « Aspects sociopsychologiques de l’hooliganisme, une vision criminologique », Pouvoirs, 62, pp. 177-130.
- Wilson, L. 2015. « What I discovered from interviewing imprisoned ISIS fighters », The Nation, 21/10/2015.
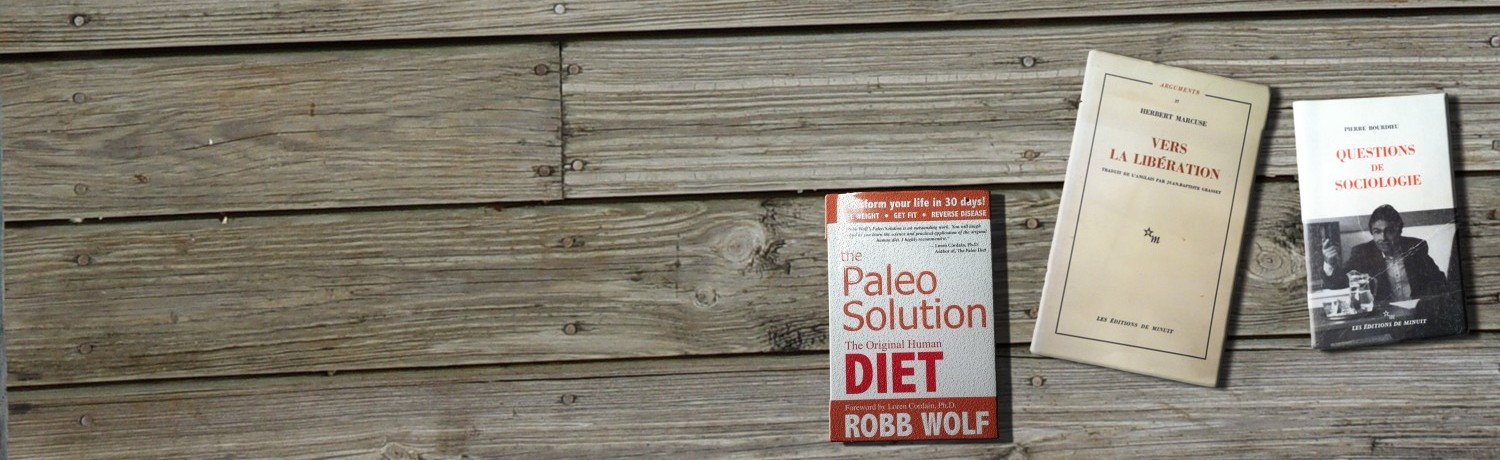
Bonjour Yves
C’est un article intéressant.
Mais as-tu une liste de livres/articles (2, 3max) qui résume bien tes idées sur l’empowerment et l’histoire du mouvement des noirs aux USA ?
C’est pour mieux comprendre tes idées et avoir une réflexion constructive.
Ps: les livres ou articles peuvent être en anglais.
Bien à toi