
Petit retour sur l’enquête “Génération Quoi ? – Autoportrait des 18-34 ans en Belgique francophone“, réalisée par la RTBF et analysée par les sociologues Johan Tirtiaux et Jérome Pieters. Pas mal de choses ont été écrites ou commentées lors de la parution de l’enquête, la semaine passée, mais je voulais revenir sur quelques éléments qui me semblent importants, dans une optique de mobilisation collective.
Les jeunes veulent s’engager : 61% d’entre eux déclarent qu’ils seraient prêts à participer demain ou dans les mois prochains à un mouvement de révolte de grande ampleur. C’est surtout le cas des ouvriers (73%) et des chômeurs (68%).
- 95% pensent que l’argent tient une place trop importante dans notre société,
- 95% pensent que la finance dirige le monde,
- 94% pensent qu’il y a trop d’injustice.
Mais l’offre politique actuelle ne répond à aucune de leurs attentes d’engagement : 90% des répondants déclarent ne pas avoir confiance dans la politique. Imaginez un peu : seule une personne entre 18 et 34 ans sur 10 a encore confiance dans la politique, telle qu’elle se présente actuellement, avec ses partis, son système électoral, ses institutions. 57% ne voudraient pas s’engager dans une organisation politique (alors que, comme on vient de le montrer, 61% seraient prêts à participer à un mouvement de révolte).

Les auteurs de l’étude rajoutent : “les jeunes semblent déçus par des hommes politiques qui ne leur paraissent pas à la hauteur des problèmes de nos sociétés et des problèmes qu’ils rencontrent“.
Et c’est bien de cela qu’il s’agit : les jeunes ont une idée claire des enjeux sociétaux. L’idée d’une jeunesse abrutie ne s’intéressant qu’à son petit confort personnel, à sa consommation ostentatoire, et à son présent, serait fausse : après la perte d’un proche, ce qui leur fait le plus peur est l’avenir (31%), à égalité avec les enjeux écologiques (31%). Dans l’ordre, ils se sentent préoccupés par :
et à son présent, serait fausse : après la perte d’un proche, ce qui leur fait le plus peur est l’avenir (31%), à égalité avec les enjeux écologiques (31%). Dans l’ordre, ils se sentent préoccupés par :
- L’environnement : 46%
- L’accès à l’emploi : 44%
- Le système éducatif : 36%
Ce à quoi on assiste est donc principalement à une crise des institutions. Ces institutions auxquelles on avait confié le pouvoir de nous éduquer, de nous diriger, de nous fournir du travail, de nous informer, etc., on n’y croit plus. Ainsi sur une échelle de 0 (“pas du tout confiance“) à 3 (“Tout à fait confiance“), la politique récolte 0,55 ; les médias, 0,73 et les syndicats, 0,99. Très peu de confiance, donc !
 L’école déçoit : 63% estiment moyennement ou fortement que l’école ne donne pas ses chances à tous. Et 82% considèrent que l’école ne prépare pas assez au marché du travail.
L’école déçoit : 63% estiment moyennement ou fortement que l’école ne donne pas ses chances à tous. Et 82% considèrent que l’école ne prépare pas assez au marché du travail.
Loin d’être “paresseux”, ces jeunes veulent travailler : 43% accordent beaucoup d’importance au travail, et 44% une importance moyenne. Seulement 13% accordent peu d’importance au travail. D’où la déception vis-à-vis de l’école : les crises économiques récentes n’ont fait qu’augmenter le chômage des jeunes. Il est passé de 18,8% à 23,2%, de 2007 à 2014, parmi les jeunes belges de moins de 25 ans (alors qu’il n’a augmenté que d’1% pour les plus de 35 ans). A Bruxelles, 36,2% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage. Plus d’un sur trois !
A ce niveau, les commentaires sur l’enquête ont beaucoup porté sur le rapport au travail. Dans l’ensemble, 56% des répondants affirment que le travail est “avant tout un moyen de gagner de l’argent” et 44% “un moyen de s’épanouir”. La surprise semblait venir du fait que l’argent arrivait légèrement avant l’épanouissement personnel. En fait, ces chiffres généraux cachent un rapport différencié au travail selon l’origine sociale.
Si 73% des ouvriers voient le travail comme un moyen de gagner de l’argent, pour seulement 27% comme un moyen d’épanouissement, le rapport est fort différent parmi les cadres : 48% y voient un moyen de s’épanouir. Le rapport s’inverse même parmi les étudiants du supérieur long : l’épanouissement dans le travail prime pour 57% d’entre eux.
C’est quelque chose qui a été longuement analysé par Bourdieu, dans “Les Héritiers” (avec Passeron) ou dans “La Distinction“, à propos de l’école : les chances objectives de réussite scolaire deviennent des perceptions subjectives de l’école. C’est-à-dire que plus on a de chances, objectivement, selon son niveau social, de réussir à l’école, plus on a une vision positive de l’école, et donc plus on investit dans sa scolarité. Au niveau du travail, plus on a des chances objectives d’atteindre un emploi épanouissant, plus on perçoit le travail comme une forme d’épanouissement. Et inversement, moins on a de chances d’atteindre un emploi épanouissant, moins on attend que notre (futur) travail nous épanouisse, et plus on attend “juste” qu’il nous apporte l’argent nécessaire à vivre… et à nous épanouir. En sociologie, on dit donc que les attentes subjectives s’accordent quasi-parfaitement aux probabilités objectives. C’est tout le fondement de la notion d’ “habitus” chez Bourdieu.

De là, prend tout son sens, la distinction entre “deux jeunesses” dans l’enquête. Ce que les enquêteurs appellent la “Génération de la Transition”, représentant 35% des répondants ; et la “Génération perdue”, représentant 33%.
La Génération de la Transition est celle de la “prise de conscience” (par rapport aux enjeux environnementaux), de la “responsabilité”, celle qui dit “Ca suffit ! On veut que ça change !“, “On veut être autre chose“. Autrement dit, c’est la génération de l’ “Empowerment“, la génération qui veut reprendre les choses en main.
A côté, on retrouve la “Génération perdue“, celle qui se sent “dans la merde”, “paumée”, “incomprise”, “à l’abandon”, “qui galère”, qui se dit : “Mais où va-t-on ?“.

D’un côté comme de l’autre, le constat est le même : le climat de crise, disent les auteurs de l’enquête, “brise le sentiment des jeunes d’être aux commandes de leur vie“. 40% estiment de façon plus ou moins prononcée de ne pas être maître de leur destin.
De nouveau, les probabilités objectives d’un avenir meilleur s’intériorisent sous forme de perceptions subjectives quant à l’avenir : celles et ceux qui ont le plus de chances d’être déclassés perçoivent d’autant plus l’avenir de notre société en terme de déclin. Et inversement, celles et ceux qui ont toutes les raisons objectives de penser que leur avenir sera positif, peuvent d’autant plus s’engager dans des initiatives visant à améliorer leur environnement social.
D’un côté comme de l’autre, la situation est vécue en terme d’impuissance, de “powerlessness“, comme on dit dans la littérature sur l’empowerment, ce qui est à la base des stratégies d’empowerment : reprendre les choses en main ; ou à l’inverse, à des stratégies d’hyper-délégation, d’abandon : lâcher prise et se remettre dans les mains d’un leader, d’un Dieu, d’un Parti. In manus Dei.

A l’heure actuelle, ces deux jeunesses représentent chacune, plus ou moins, un tiers des jeunes. Ce qui laisse un troisième tiers, dessinant le triptyque que j’ai essayé de décrire ici : celles et ceux qui se lancent dans des stratégies d’empowerment, de transition, d’auto-organisation ; celles et ceux qui risquent de se raccrocher à des mouvements de repli identitaire ou nationaux ; et celles et ceux qui, entre les deux, essayent de garder la tête hors de l’eau.
L’enjeu, pour les mouvements de la transition, qui prennent beaucoup d’ampleur en Belgique francophone est de noter que :
- un tiers de la jeunesse se définit elle-même comme la « Génération de la transition » ;
- un autre tiers de la jeunesse, originaire de milieux sociaux plus modestes, partage le même constat, mais se sent perdu, abandonné ;
- les jeunes rejettent majoritairement les moyens traditionnels d’engagement politique. Il faut donc inventer de nouvelles formes d’engagement.
Pour en savoir plus sur le réseau Transition en Belgique : http://www.reseautransition.be/
Pour en savoir plus sur le réseau Transition en France (plus de 2000 initiatives !) : http://www.transitionfrance.fr/
Là où je m’investis : Genappe en Transition
Références :
- Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. 1964. Les héritiers. Les étudiants et la culture, Paris : Editions de Minuit.
- Bourdieu, P. 1979. La Distinction, Paris : Editions de Minuit.
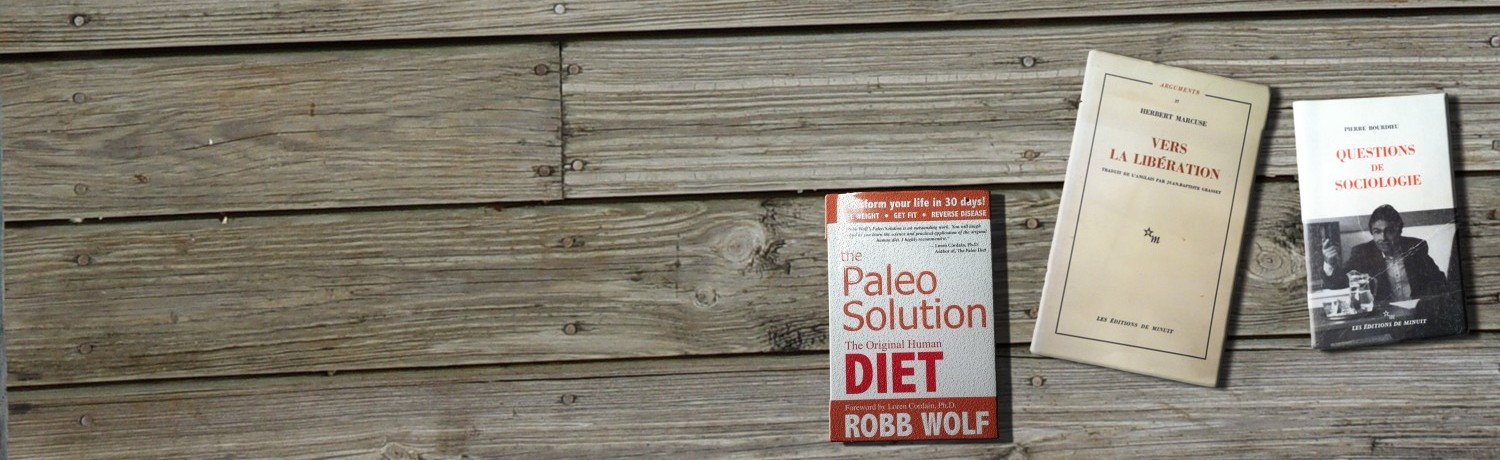




 Twitter
Twitter Facebook
Facebook LinkedIn
LinkedIn